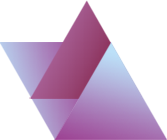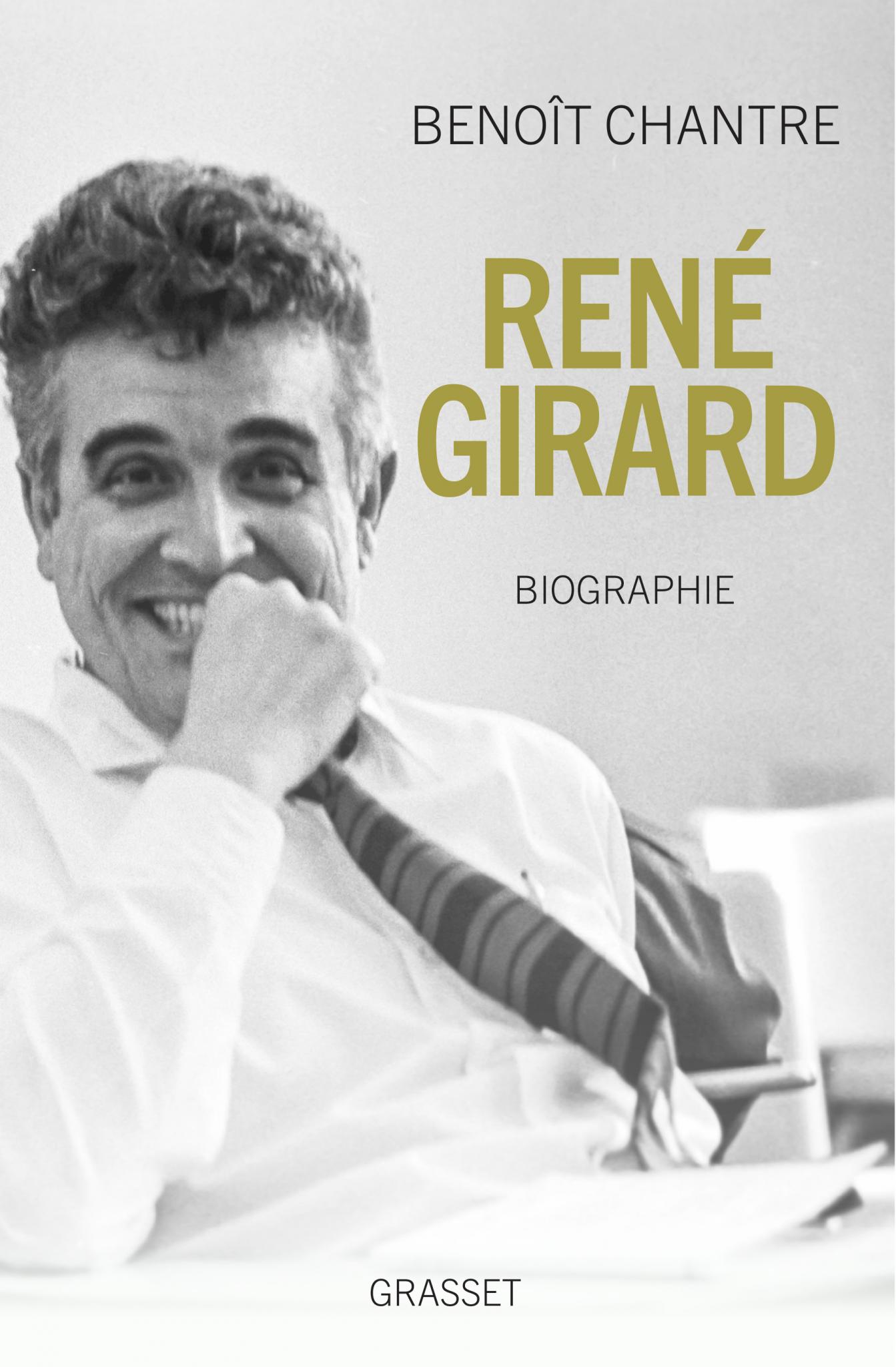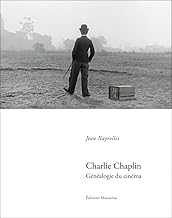Chroniques d'Eric Gans
CHRONIQUES D'OUTRE ATLANTIQUE
|
|
La fin du sens commun
|
|
|
Dans l’univers de René Girard, peu importe la motivation exacte du meurtre émissaire ; ce qui en résulte, c’est la différence durkheimienne entre sacré et profane, entre la divine victime signifiée et le reste de l’univers insignifiant - focalisation qui garantit la paix. Dans le scénario de l’anthropologie générative, qui met au centre une source de nourriture plutôt qu’une victime « émissaire », l’aboutissement est le même : l’établissement de l’ordre au moyen du signe qui distingue le sacré en laissant le profane dans l’ombre. Toute la différance de l’humanité, c'est-à-dire sa capacité à différer la violence au moyen de la représentation, tient dans cette opposition. Dans le domaine de l’anthropologie, le sacré n’existe qu’en elle, et à la fin n’est qu’elle.
En somme, les proto-humains, trop « mimétiques » pour supporter la hiérarchie naturelle des bêtes, créent le sacré pour pouvoir se sentir tous |
également démunis par rapport à lui. La rage que provoque parmi nous une inégalité quelconque ne fait que refléter l’unique axiome de la morale : tous égaux devant le sacré.
Ce qui a suffi, au départ de l’humanité, pour maintenir une égalité primitive de condition. Mais depuis l’invention de l’agriculture à l’époque néolithique, il s’est révélé que toutes les inégalités humaines sont permises pourvu que le sacré, qui reste « transcendentalement » supérieur à tous, riches et pauvres, humbles et puissants, puisse garantir un minimum d’ordre et de bien-être. Et au fil des siècles, le dialogue de l’égalité sacrée et de l’inégalité mondaine a fait naître un système économique dont les acteurs échangent leur travail, et certains le revenu de leurs capitaux, contre des articles de consommation, système qui permet aux habitants des pays riches de vivre confortablement, et à ceux des autres pays d’espérer à l’avenir un train de vie similaire.
Cependant, la vague de ressentiment qui déferle actuellement sur le monde, et dont l’islam militant est devenu pour l’instant le moyen d’expression privilégié, met en question ce tableau idyllique. La réalité du monde contemporain semble s’en éloigner de plus en plus, non pas dans le sens que le voudraient les staliniens non repentis qui dénoncent les méfaits du « capitalisme » et de « Wall Street », mais pour une raison que tout le monde reconnaît sans en saisir pour autant la véritable portée anthropologique. Personne n’ignore que le secteur économique dans les pays avancés est en train de devenir trop « numérique » pour pouvoir employer beaucoup de travailleurs manuels. Mais nous n’avons pas encore compris ce qu’il y a de profondément inhumain dans ce développement. C’est qu’il risque de mettre fin au principe de solidarité qui unit notre espèce depuis la scène d’origine proposée par l’anthropologie générative : la possibilité pour tous d’échanger des signes à titre égal.
Lorsque Descartes disait que « le bon sens est la chose la mieux partagée », il ne parlait pas de « l’intelligence » mais d’une chose bien plus précise : notre faculté linguistique. Ce que Descartes appelle « le bon sens » est tout simplement la capacité de l’homme moyen d’utiliser le langage pour « faire du sens », pour exprimer des pensées qui ne se contredisent pas ouvertement et qui correspondent à une figuration de la réalité assez cohérente pour être communiquée à un interlocuteur. Or au cours des dernières décennies, pour la première fois de l’histoire, ce partage universel du « sens commun » commence à faire défaut.
Le problème ainsi posé par cette désolidarisation est grave, et sa solution est loin d’être évidente. Mais ce qui est plus grave encore, c’est qu’on peut y voir une préfiguration de la mise en question définitive et ultime, par nos propres moyens, de l’intelligence symbolique qui définit l’humanité.
*
* *
Notre monde traverse actuellement une crise dont la résolution nous échappe. La naissance de la machine de Turing au moment de la dernière guerre mondiale n’a rien d’une coïncidence ; à la limite de la violence humaine correspond le début de l’univers « post-humain ». Aujourd’hui, à l’ère du design cybernétique et de l’usine robotisée, la catégorie de la « force de travail » chère aux marxistes, qui jusqu’à une date récente restait grossièrement fonctionnelle dans l’économie de marché - une heure de travail qualifié dans une usine ou sur un chantier en valant à peu près une autre - perd de plus en plus sa raison d’être. On peut se demander si Marx lui-même oserait mesurer aujourd’hui la valeur d’une marchandise aux heures de travail que sa fabrication a coûtées aux ouvriers.
De plus en plus, les emplois les plus productifs dans les pays riches dépendent plutôt de connaissances « symboliques ». Au minimum, ils exigent la capacité de communication écrite et orale correspondant au premier diplôme universitaire, et le plus souvent, des connaissances techniques bien plus avancées. C’est dire que, pour la première fois de l’histoire, on commence à exiger non plus d’un cadre de spécialistes mais du travailleur moyen une capacité de manipuler les symboles qui dépasse nettement les limites du « sens commun » qu’on peut raisonnablement attribuer à tous.
Il me semble que c’est parce qu’on sent que ce pacte fondamental est ébranlé qu’on se scandalise tellement en Amérique et ailleurs de la disproportion des revenus et des fortunes - disproportion qui n’a pourtant rien de nouveau. La frustration engendrée par l’immobilité des salaires de la classe ouvrière au cours des dernières décennies, et la peur que la jeune génération risque de ne pas vivre aussi confortablement que ses parents, me paraissent également des reflets d’une frustration et d’une peur plus fondamentales.
Derrière l’obsession de l’inégalité, derrière la montée du ressentiment racial et ethnique, se profile une angoisse bien plus profonde : celle d’assister à un clivage parmi les hommes qui ne s’explique ni par l’intolérance ni par la rapacité des riches, mais tout simplement par l’écart croissant, et qui ne sera plus jamais comblé, entre ceux qui doivent se contenter d’œuvrer de leurs mains et ceux qui sont aptes à manipuler un langage mathématique, scientifique, technique, juridique, administratif…
Ceux qui pratiquent des métiers manuels spécialisés tels les plombiers ou les soudeurs sont toujours bien rémunérés, mais nous ne sommes plus aux temps où l’Américain ou le Français moyen pouvaient toucher un bon salaire en travaillant sur une chaîne de production. La situation favorable des « Trente Glorieuses » ne se reproduira plus, et à scruter l’avenir, la classe ouvrière n’a aucune raison d’espérer que son sort s’améliorera. Chez les blancs comme chez les noirs, l’égalité de base fondée sur le partage d’un univers symbolique commun se défait à vue d’œil. Voilà donc où nous en sommes.
Mais il y a peut-être pire. Il est certain que l’évolution darwinienne ne suffit pas pour expliquer l’émergence de notre espèce, qui se définit par le sacré ou plus simplement par la parole. Me fondant sur cette vérité, qui n’est pourtant pas évidente à tous, j’ai longtemps résisté à l’idée que l’intelligence des machines puisse jamais être comparée à celle des humains - ce qui entraînerait qu’elle puisse un jour la dépasser.
Un ordinateur n’est qu’une machine à algorithmes. Il ne saurait posséder comme le plus humble d’entre nous une scène de représentation mentale où notre pour-soi, pour parler comme Jean-Paul Sartre, fait comparaître des objets « néantisés », c’est-à-dire libérés de nos pulsions instinctives envers eux, ce qui nous permet de les représenter par les signes et donc de les penser. Mais stipulons que cette scène intérieure est une chose impossible à simuler par l’intelligence artificielle, qui n’ayant pas de pulsions n’a pas besoin d’en être protégée. Cette scène ne vaut finalement qu’en tant qu’atelier où nous manions les signes dans le but de manipuler la réalité extérieure. Si une machine arrive à manier les signes aussi bien que nous, sinon mieux, de quel droit lui refuserions-nous la catégorie de « l’intelligence » ?
Nous ne savons pas encore précisément à quoi nous en tenir sur l’avenir de l’intelligence artificielle, mais il me semble qu’on devrait opposer le même scepticisme à l’optimisme béat des futuristes comme au pessimisme des « humanistes ». On ne voit pas bien quels indices nous feraient imposer des limites futures à la cybernétique. Je ne parle même pas - autre cauchemar - de robots ivres de pouvoir qui anéantiraient notre espèce ou la réduiraient en servitude. Quoi qu’en pensent les auteurs de science-fiction, aucun degré d’intelligence numérique ne ferait naître de lui-même dans des machines une volonté autonome - celle de nos ennemis humains suffirait largement de toute façon.
Ces rêves apocalyptiques mis à part, si les machines parvenaient à penser mieux que nous, à dessiner mieux que nous, à écrire mieux que nous… quel avenir espérer alors pour l’humanité ? Pourrons-nous compter sur des manipulations génétiques, voire sur des implants électroniques, pour nous maintenir au niveau intellectuel de nos machines ?
Pour le moment, il faut parer au plus pressé. Renforçons les liens familiaux, améliorons les méthodes pédagogiques, imposons aux jeunes une discipline sécurisante – faisons tout pour relever le niveau de ceux qui seraient autrement insuffisamment qualifiés pour le travail symbolique. Essayons de bien former la prochaine génération, car c’est elle qui aura à affronter les cauchemars insondables de l’avenir.
|
|
"Situation de la France" de Pierre Manent (Desclée de Brouwer, 2015)
|
|
|
La réponse à donner au retour de l’islam est aujourd’hui devenue un enjeu de politique nationale à la fois brûlant et délicat. Pour avoir esquissé les contours d’un concevable modus vivendi, Pierre Manent a été accusé par Pascal Bruckner de défaitisme (« Une grande leçon de défaitisme », Le Point, 25 septembre).
Pour l’auteur de Situation de la France, la crise actuelle enseigne aux Français la nécessité d’une réaffirmation de leur conscience nationale après l’effritement des dernières décennies, à la fois pour faire face au défi de l’islamisme et parce qu’indépendamment de l’islam, la France le requiert pour survivre. Je n’aborderai pas ici la question, que le livre soulève en passant, de la viabilité de la société « des droits de l’homme » en France et dans l’ensemble de l’Europe. La civilisation occidentale sécularisée, s’étant débarrassée de tout principe de cohésion sociale, est-elle apte à survivre ? La poussée de l’islamisme n’est-elle au fond qu’une réaction aux signes d’effondrement, comme l’étaient les invasions barbares au tout début du Moyen Age ? Je reprendrai cette question dans de futures Chroniques. |
Etant donné la nature « intercommunautaire » de notre sujet, l’Amérique fournit un point de comparaison utile. A l’occasion des débats autour du foulard, il y a quelques années, la chose la plus difficile à expliquer aux jeunes Américains était le problème que pouvait poser le port d’un simple tissu. Aux Etats-Unis, les juifs croyants portent bien leur kippa en classe, une croix très apparente y est la bienvenue, et depuis quelque temps les « foulards » font aussi leur apparition. On pourrait aller jusqu’à se demander si ce que Pierre Manent envisagerait n’est pas, au fond, l’ouverture de la laïcité française à quelque chose comme l’identité américaine « à trait d’union » qui nous donne tout loisir de nous présenter comme Italien-Américain, Africain-Américain, Chinois-Américain - « communautarisme » qui va de pair avec le traditionnel « creuset » (melting-pot) de l’unité nationale.
Mais l’exemple américain nous permet en même temps de voir plus clairement la nature double du problème posé par l’intégration des musulmans. Pour nous, l’adaptation aux mœurs étrangères, pourvu qu’elles n’enfreignent pas les lois du pays, ne saurait poser un grave problème. Tous fils et filles d’immigrants, nous en avons l’habitude depuis toujours. Par contre, l’existence au sein de la communauté musulmane, en Amérique comme en France, de djihadistes protégés en grande mesure par cette communauté, comme on vient de le constater à San Bernardino, où l’attentat de décembre 2015 fut préparé de longue date sans que personne ne tire le signal d’alarme, n’est pas tolérable. Il me semble que malgré l’énorme différence entre la présence musulmane en France et aux Etats-Unis, la même fermeté doit prévaloir dans les deux pays. Essayons d’en tirer les conséquences.
***
Je n’ai presque rien à redire à la manière dont Pierre Manent oppose l’islam au christianisme :
Le contraste politiquement le plus pertinent entre la chrétienté et l’islam tient alors en peu de mots : l’islam n’a jamais pu abandonner la forme impériale que la chrétienté n’a jamais pu prendre durablement, trouvant en revanche sa forme dans la nation, ou dans la pluralité de nations appelée d’abord précisément « chrétienté » puis « Europe ». (p. 88)
Le principe monothéiste qui fonde le judaïsme se révèle au moment où Dieu se définit, en Exode 3, comme n’ayant d’autre nom que son identité à lui-même (« je suis ce que je suis »). L’unicité de Dieu est le fondement de la pensée rationnelle, partagée par tous, et de la morale qui en découle, croyance qui fonde la nation juive, qui a pour mission en tant que « lumière des nations » de la promulguer au monde entier. Cette croyance fondamentale en un Dieu unique n’est pas identique à la loi juive proprement dite, dont le but est de renforcer la communauté dans sa fidélité envers Dieu.
En revanche, le christianisme lie la définition de l’être humain à la présence de Dieu : à la fois hors de lui (le Père), en lui (le Saint-Esprit), et conforme à lui (le Fils). Puisque ce qui permet à l’homme de vivre est la différance de sa violence, le moyen privilégié par lequel Dieu nous le fait comprendre, c’est en subissant cette violence lui-même, débarrassant du coup le rite sacré de sa fonction mondaine, alimentaire, et de la « loi » qui la soutenait. Le christianisme naît sous l’Empire, mais Pierre Manent a bien compris que son expression politique essentielle est la nation, qui prend modèle sur la nation juive. Cette nation est à son tour « enracinée » dans un territoire gouverné par des lois terrestres inspirées par la loi morale du Royaume « qui n’est pas de ce monde ».
L’islam s’est défini au septième siècle contre le christianisme et le judaïsme comme une religion de tribus en marge de la civilisation chrétienne et impériale. C’est une foi non seulement qui refuse toute dichotomie entre loi humaine et loi divine, mais qui est fondée sur le refus de cette distinction telle qu’elle avait évolué au cours de l’histoire judéo-chrétienne, où les rôles du roi et du grand-prêtre n’ont jamais été confondus. Je ne dirais même pas comme Manent que l’islam est impérial ; il est trans-impérial, l’oumma se confondant en principe avec l’humanité entière.
Pierre Manent se rend compte que la sharia est qualitativement différente des lois religieuses qui gouvernent les chrétiens et les juifs, mais on peut se demander si les accommodements qu’il suggère prennent vraiment la mesure de cette différence. A part le refus du voile intégral et de la polygamie, il mentionne trois autres mesures : la provision de repas sans porc à l’école (p. 72), l’acceptation d’horaires séparés pour garçons et filles dans les piscines (ibid.), et l’interdiction du financement des mosquées par des pays étrangers (p. 135-39) - chose curieuse, il ne parle pas du « foulard ».
Bien entendu, dans la vie réelle des compromis sont toujours possibles, et l’incompatibilité de fond entre deux ou plusieurs religions - et toutes les religions occidentales sont en principe incompatibles entre elles en raison de leur nature totalisante - n’empêche pas leurs adhérents d’habiter ensemble ni de collaborer au projet national. Mais l’objection qu’on peut faire à un tel projet de collaboration est de savoir quelle force ou quelle « instance » va freiner l’ambition totalisante des religions en question. Or Manent ne soulève jamais la question qui est à mon sens capitale : est-ce que le rapport entre l’ambition spirituelle idéale de la religion et son extension mondaine réelle est compatible dans chaque cas avec une collaboration authentique, ou s’agirait-il seulement ici d’un compromis « stratégique » ? Il me semble que les diverses branches de la religion chrétienne, pour laquelle le royaume de Dieu « n’est pas de ce monde », se contentent d’attendre le retour du Christ sans chercher à imposer sa loi au monde entier, alors que pour l’islam, qui se définit comme une communauté de croyants destinée à inclure le genre humain, l’universalité réelle est ardemment désirée. Il s’ensuit qu’une participation effective de la communauté musulmane au projet national français n’est possible que sur la base d’un renoncement de la part de l’islam à son élan conquérant. Et le seul moyen fiable de provoquer un tel renoncement est d’administrer la preuve, par la force s’il le faut, que la conquête rêvée ne se fera pas.
La formule proposée par Manent, qu’on agisse en sorte que les musulmans français deviennent « capables de faire recevoir entièrement leur appartenance musulmane par la nation française » (p. 140), me paraît incompatible avec ce que les musulmans, même ceux qui observent la sharia sans jamais enfreindre les lois de l’Etat, considèrent comme la pratique authentique de l’islam. Pour que cette formule ait néanmoins une chance de succès, il faudrait que l’attachement souhaité à la nation française soit motivé par le jugement que, sur le sol de la France au moins, l’Etat français est plus fort que l’islam. Pourtant, comme Manent l’affirme à plusieurs reprises, l’Etat français s’est beaucoup affaibli ces derniers temps. Ne faut-il donc pas en conclure que ce qui est avant tout nécessaire aujourd’hui pour réconcilier les musulmans français avec la France, ce serait la défaite du djihad international ? Tant que celui-ci a l’air de triompher, ou tout simplement de tenir face à l’hostilité occidentale, on est en droit de douter que les jeunes musulmans non encore intégrés à la vie économique et politique des pays d’Europe préfèreront l’intégration nationale à leur identité musulmane. La tentative de promouvoir dans les conditions actuelles une identité franco-musulmane telle que Manent la conçoit, aussi forte et louable soit-elle, me paraît donc prématurée.
***
Les chrétiens et les juifs ont pu et peuvent encore recevoir leur appartenance religieuse de la nation française, les premiers parce que le christianisme n’impose pas une « loi » dans la vie quotidienne et que ses coutumes sont déjà intégrées à la société française, les seconds parce qu’ils partagent depuis la Révolution et l’Empire toute une histoire d’émancipation et d’intégration. Mais l’islam se définit, lui, comme la soumission à la loi divine, et suppose l’abnégation de toute liberté par rapport à Allah. Pourquoi soulève-t-il aujourd’hui tant d’enthousiasme ? Parce qu’après un long hiatus, il est de nouveau en marche. La soumission qu’il exige est quasi militaire. On ne questionne pas les commandements au cours d’une bataille, et l’on ne déserte pas une armée triomphante.
Il faudra donc mettre fin au rêve du califat restauré. Après, les compromis sur le modèle de la tolérance américaine pour le foulard seront les bienvenus. Après, la France et l’Europe entière seront à même de traiter avec la communauté musulmane de puissance à puissance, car la victoire aura redonné à l’Occident une bonne part de l’énergie nécessaire pour arrêter son déclin. Mais pas avant.
Janvier 2016
|
|
Décembre 2015
|
|
|
J’étais sur le point de soumettre cette chronique lorsque j’ai appris la nouvelle à la fois choquante et inévitable de la mort de René Girard, et ensuite celle, affreuse et sans doute non moins inévitable, des massacres de Paris. Que ces Chroniques soient un hommage de plus à la mémoire de René aussi bien que l’expression de ma conviction que sa pensée justement comprise est une arme puissante contre la violence.
Qui suis-je ? |
Ce regard d’outre-Atlantique provient plutôt du Pacifique : j’écris de Santa Monica, à moins de deux kilomètres de l’océan - juste assez loin et surtout assez haut pour ne pas craindre les tsunamis dont nous menacent les météorologues. C’est de ce côté-ci de l’Amérique, qui regarde au loin une Asie imaginaire, que l’on est sans doute le mieux situé pour porter un regard objectif sur l’Europe, dont non seulement un océan, mais tout un continent nous protège de la présence mimétique.
Depuis bientôt trente-cinq ans je me consacre à l’anthropologie générative, inspirée en bonne partie par la pensée de Girard, qui fut mon directeur de thèse à Johns Hopkins dans les années 1960, et dans une moindre mesure par la « différance » de Jacques Derrida, interprétée comme différant la violence qui menace toute œuvre humaine. Je publie depuis 1995 Anthropoetics, revue électronique semi-annuelle, auquel j’ajoute à titre personnel des Chroniques de l’amour et du ressentiment qui seront bientôt au nombre de 500. De plus amples informations se trouvent sur notre site web : www.anthropoetics.ucla.edu.
Je suis depuis le début de 2015 à la retraite de l’Université de Californie, Los Angeles (UCLA) où j’ai enseigné pendant 45 ans la littérature française, surtout celle du XIXe siècle, le cinéma français, et ce qu’on avait naguère l’habitude d’appeler la « French theory », y compris bien entendu la pensée girardienne.
***
J’ai fait la connaissance de Girard en 1960, lorsque je suis arrivé à Baltimore à l’âge de dix-neuf ans pour poursuivre un doctorat à la Johns Hopkins University. La gloire de Hopkins à l’époque était le grand érudit judéo-allemand Leo Spitzer, échappé aux nazis comme tant d’autres. Mais par malheur Spitzer est mort un mois ou deux avant mon arrivée, de sorte que j’ai débarqué dans un département en deuil. Dans ce petit monde, où il n’y avait que cinq ou six professeurs pour toutes les langues romanes, Girard, encore dans la trentaine et pas encore très connu, était de loin le plus charismatique et le plus brillant. Il allait bientôt faire sa réputation avec Mensonge romantique et vérité romanesque, qui a paru dans le courant de cette même année universitaire.
René a dirigé ma thèse, sur les œuvres de jeunesse de Flaubert, très assidument, mais d’une main légère, attentif surtout à m’encourager à bien m’expliquer et à combattre une fâcheuse tendance à ce qu’il appelait le dandysme intellectuel - attitude qui n’était pas étrangère à cette même French theory que René allait tant faire pour répandre aux Etats-Unis avec un colloque historique à Hopkins en 1966.
Muni de mon doctorat, je développais des notions empruntées à l’école de Gregory Bateson - le théoricien du double bind -, en particulier celle du paradoxe pragmatique qui me semble encore être au cœur de l’expérience esthétique et plus généralement de tout phénomène culturel. Parmi mes écrits de cette époque se trouvent un « essai » sur « l’esthétique paradoxale », une étude du « drame tragique » de Musset, et de petits volumes sur la Mosaïque de Mérimée et la tirade du labyrinthe de Phèdre - que je considère toujours comme le passage le plus « performant » de la littérature française.
Mais il me manquait pour situer ces analyses une anthropologie fondamentale. C’est ce que Girard a fourni apporté en 1972 avec La Violence et le sacré, le premier ouvrage, depuis Totem et tabou de Freud soixante ans plus tôt, à offrir, avec une envergure intellectuelle et une information anthropologique qui dépassent de loin l’horizon freudien, le modèle d’une scène originaire collective.
Il avait manqué à la collectivité « patrocentrique » de Freud l’élément fondamental de l’humain qui est la représentation. Sans doute la description que Girard fait de ce qu’il appelle le « mécanisme victimaire » ne met pas cet élément en avant, mais il n’en est pas moins essentiel à son propos. Car malgré son silence au sujet du langage, la désignation collective de la victime comme cible de la violence « unanime » est déjà, pour ainsi dire sans le savoir, l’énonciation d’un signe symbolique, en fin de compte, d’une locution. Assaillir la victime qu’on a montrée du doigt - à la différence du meurtre du père-roi freudien qui n’a pas besoin d’être ainsi re-présenté parce qu’il occupe déjà la position centrale - c’est créer « pour la première fois » la configuration uniquement humaine de l’attention conjointe partagée que notre espèce a vouée à un si grand avenir.
Pour compléter l’anthropologie générative, le dernier élément catalyseur m’a été fourni à la fois par Des choses cachées depuis la fondation du monde (1978), où Girard révélait pour la première fois sa pensée religieuse, et surtout par un semestre passé à ses côtés à Johns Hopkins cette même année - qui devait être mon dernier contact intensif avec lui. C’est à la suite de cette visite que je me suis mis à construire le système qui a vu le jour en 1981 avec The Origin of Language.
Pour ceux qui lisent l’anglais j’ai raconté plus en détail mes rapports intellectuels avec René dans un petit volume intitulé The Girardian Origins of Generative Anthropology, accessible gratuitement en ligne à http://www.imitatio.org/uploads/media/Gans-GOoGA.pdf
*
* *
J’ai commencé mes Chroniques américaines (http://www.anthropoetics.ucla.edu/views ) il y a vingt ans, à une époque qui semble aujourd’hui étonnamment lointaine. Les années 1990 furent une dernière « belle époque » où l’Amérique et l’Occident tout entier célébraient leur victoire dans la Guerre froide, victoire non seulement pacifique mais qui laissait prévoir un rapprochement voire une fusion du bloc soviétique avec le nôtre. C’était le moment où Francis Fukuyama occupait les manchettes des revues de science politique avec sa déclaration téméraire que cette victoire inaugurait la « fin de l’histoire » pressentie par Hegel au moment des conquêtes napoléoniennes. On aurait donc atteint avec la démocratie libérale, qui joignait au marché économique « libre » un mécanisme électoral qui constituait en parallèle un « marché » politique, l’apogée de l’organisation sociale humaine.
Je continue de respecter la part de vérité dans cette perspective : ce ne sont pas les accomplissements de la Chine capitaliste-autoritaire ni encore moins ceux du nouveau « califat islamique » qui mettront en doute la supériorité du double marché économique et politique pour ce qui est de la libération des énergies humaines productives et expressives. Sans doute Fukuyama, qui tenait un peu trop à l’aspect publicitaire de sa thèse et qui subissait un peu trop aussi l’influence hypnotisante d’Alexandre Kojève, n’a-t-il pas assez insisté sur l’aspect pré-historique de cette « histoire » hégélienne, qui finit avec la révélation totale du Weltgeist, et qui devait être suivie par ce que Marx appellerait le « royaume de la liberté ». Mais hélas, plus de vingt ans après « la fin de l’histoire », nous sommes encore empêtrés dans des questions bassement « historiques ».
Sous la présidence de Clinton (1993-2001) il y eut déjà un certain nombre d’attentats islamiques en Occident, y compris celui contre le World Trade Center en 1993, mais aucun incident d’avant 2001 n’avait suffisamment d’envergure pour faire croire au « choc des civilisations » auguré par Samuel Huntington en 1993. Depuis, la situation est devenue bien plus grave. Aujourd’hui comme jamais l’Occident judéo-chrétien et euro-américain a besoin de présenter un front uni contre les forces destructrices qui se trouvaient naguère à l’intérieur de lui (nazisme, stalinisme), mais qui depuis la fin de la Guerre froide se concentrent dans l’Islam militant. Car bien que la Chine semble s’affirmer de plus en plus sur le plan tant militaire qu’économique, sa rivalité avec les Etats-Unis ne vise nullement à les conquérir et encore moins à les détruire. Et Poutine, bien que d’un aventurisme inquiétant pour les anciennes « colonies » soviétiques, est au fond un défenseur de l’Occident. Son alliance avec l’Iran chiite n’est pas tant anti-américain ni anti-chrétien qu’anti-sunnite.
L’Etat islamique, c’est autre chose. Il inquiète moins par sa puissance militaire - qui ne cesse pourtant de croître - que par sa force spirituelle. On a tort de voir dans son théâtre barbare l’expression d’une sauvagerie déchaînée - il s’agit d’actes de foi (autos da fè) mis en spectacle d’une manière savante pour illustrer devant des adhérents en puissance la discipline terrible de la soumission conquérante qui est depuis toujours la marque authentique de l’Islam.
Je pense que le document le plus effrayant du nazisme n’est pas un quelconque discours de Hitler mais l’allocution de Himmler aux SS en 1943 : « La plupart d’entre nous savent ce que c’est que cent cadavres alignés les uns à côté des autres, ou 500, ou 1.000. Avoir tenu dans ces circonstances-là et, à part quelques cas exceptionnels de faiblesse humaine, être restés honnêtes, cela nous a endurcis. C’est une page glorieuse de notre histoire (elle n’a jamais été écrite, et ne le sera jamais). » Massacrer par centaines, par milliers, ce n’est pas un déchaînement libidinal, c’est l’accomplissement d’un devoir sacré. C’est cette mise en œuvre d’une violence disciplinée et sans pitié qui est le point de contact le plus frappant entre le djihadisme et l’hitlérisme - sauf que ce dernier, pratiqué en territoire chrétien, dut garder le silence sur ce que Daech étale en plein jour. Voilà la leçon de ces vidéos de décapitations et d’autres atrocités qui font tant de recrues pour eux.
Mais il est trop tôt pour désespérer. Notre vieille culture occidentale a autre chose à offrir à sa jeunesse qu’un choix entre l’hédonisme et la décapitation. Seulement il faudra qu’en suivant l’exemple de René Girard, nous approfondissions les racines religieuses et anthropologiques de cette liberté spirituelle qui est le grand don de l’Occident au monde. Voilà donc la mission de ces « Chroniques d’outre-Atlantique », où je chercherai à mettre en avant tout ce qui nous donne des raisons de croire au renouveau de l’esprit occidental.
*
* *
Maintenant, l’introduction est faite. La prochaine Chronique examinera la provocante Situation de la France de Pierre Manent, dont les tristes événements des derniers jours n’ont fait qu’accroître la pertinence.