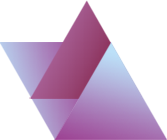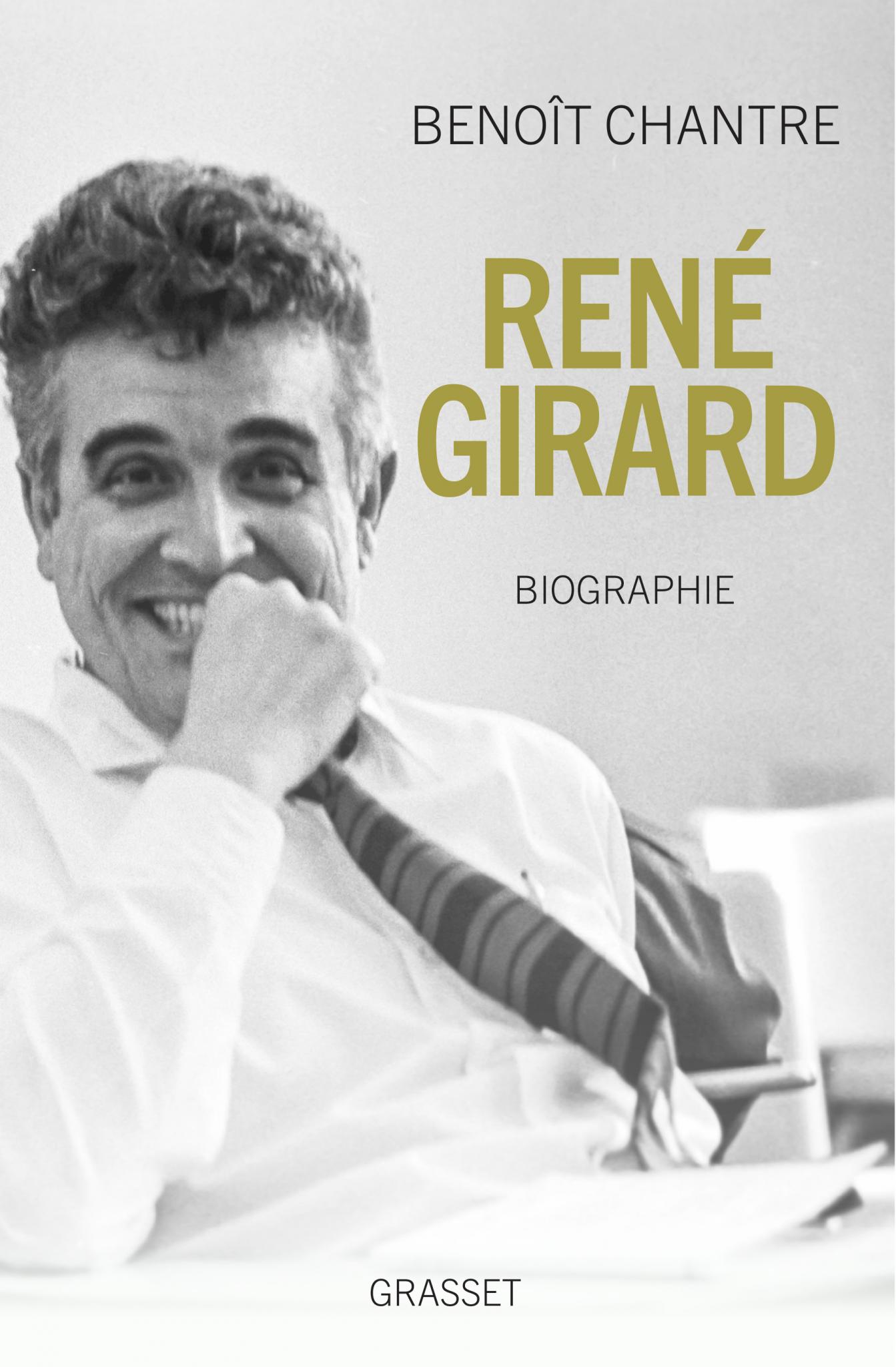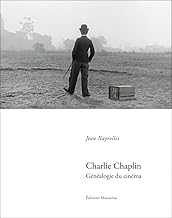Friedrich Hölderlin
Art Press janvier 2020
Entretien avec Benoît Chantre, à propos de son livre "Le Clocher de Tübingen
Oeuvre-vie de Friedrich Hölderlin"

Dans le prologue de votre livre, intitulé Automne allemand, vous évoquez le « climat guerrier » de la fin des années 1970 où deux camps s'affrontent : celui de la Rote Armee Fraktion et celui des partisans d'une raison d'Etat implacable. Pouvez-vous revenir sur ce qui vous a amené à choisir cette période comme point de départ de votre ouvrage ?
Il me fallait trouver une accroche. Car Hölderlin est quasi inconnu en France… comme en Allemagne ! puisque les nazis ont récupéré son œuvre dans les années 1930. Heidegger en a fait ensuite le « poète de l’être allemand à venir », ce qui ne l’a pas servi non plus. Je devais donc évoquer l’écran terrible de ce passé, mais dire aussi qu’on ne pouvait comprendre l’œuvre que dans le contexte franco-allemand. Il ne faut pas oublier que Hölderlin, Hegel et Schelling rêvent de construire une République souabe au cœur de l’Europe, au moment même où se crée une République batave avec le soutien des armées révolutionnaires françaises. Hölderlin sera même impliqué dans un complot contre le duc du Wurtemberg, et échappera de justesse à la prison de Stuttgart. Or ce dernier événement a lieu au moment où il publie ses traductions d’Œdipe tyran et d’Antigone. J’ai été très frappé de découvrir qu’Antigone était redevenue, deux siècles plus tard et dans la même région, une des figures de proue de l’opposition extra-parlementaire. Quand les réalisateurs de Deutschland im Herbst (« Automne allemand »), après la mort de Baader et de ses deux complices en prison, demandent à Heinrich Böll d’adapter l’Antigone de Sophocle, on voit à quel point les rêves de tyrannicide du début du xixe siècle se sont violemment transformés à la fin du xxe. Hölderlin avait déjà compris qu’Antigone n’était pas la véritable héroïne de la pièce, et que ce n’était pas non plus Créon - que le véritable sujet, c’était la relation de l’un à l’autre, soit la violence symétrique du « blasphème » et de la répression. C’est parce qu’il a vu apparaître cette montée aux extrêmes de la violence qu’il a décidé de se taire. Je ne crois donc pas du tout à la légende de sa folie, mais bien à son « hyper-lucidité ». Il devient alors, au moment même où se trame la réponse violente de la future Allemagne à la France, un résistant de l’intérieur.
Comment la forme de votre livre s'est-elle imposée à vous ? Un tel sujet nécessite-t-il d'écrire en poète ?
Le sujet de mon livre n’est autre que la conversion ou le « retournement natal » (vaterländische Umkehr), qui seul explique le silence de trente-six ans du poète à Tübingen. Il s’agit là d’une expérience tragique, mais elle n’est pas réductible à la folie. Hölderlin a vécu une profonde conversion au mitan de sa vie. Elle a manifestement lieu pendant son voyage en France en 1802. Quand il revient dans son village de Nürtingen, ses proches ne le reconnaissent pas. Que s’est-il passé ? Tout laisse à croire qu’il a fait une expérience mystique peu de temps avant d’apprendre la mort imminente de la seule femme qu’il eût aimée, Susette Gontard. Il y a là une forme de court-circuit ou une vivace contradiction qu’il ne pourra supporter. Echec de la révolution souabe, échec d’une carrière universitaire ou dramatique (La Mort d’Empédocle ne sera pas achevée), mort d’un unique amour. Et pourtant les quatre années qu’il va passer avant son internement en 1806 seront très fécondes pour sa poésie. Il achève ses plus beaux hymnes dans cette période. C’est sur ce mystère du « retournement » hölderlinien que je me suis donc attardé. Il me fallait plonger le lecteur dans la nuit de cette « œuvre-vie », afin d’y faire apparaître, l’une après l’autre, des constellations très précises. Je pense en effet que, dans le chaos de cette existence malmenée comme un bouchon sur la vague, ce sont les éléments d’un système poétique qui se sont précisément mis en place. Mon livre part à la recherche de ce « diamant dans la mine ». C’est au moment où je suis arrivé aux Remarques sur Œdipe et Antigone, que l’idée du prologue s’est imposée. Comme s’il m’avait fallu commencer et finir par Antigone, partir de la fin pour revenir au début. Ce « retournement du temps » est conforme à la méthode hölderlinienne. Mais ce qu’on trouve à l’aube du xixe siècle, quand les intellectuels allemands rêvent encore à Rousseau et à une communion possible des hommes avec la nature, ce n’est pas une insurrection contre la violence de l’Etat - c’est une condamnation radicale de la violence, au contraire. Remonter le cours de l’Allemagne moderne, c’était donc tenter de retrouver l’énergie poétique et spirituelle de cette origine trahie, tenter de réveiller le rêve poétique et politique dont Hölderlin aura été l’aède et qui meurt avec lui.
Les relations entre nature et culture sont au cœur du questionnement hölderlinien. Le poète entre en extase devant la Nature comme s'il avait l'intuition que l'homme est sur le point de lui porter atteinte de manière irréversible. Qu'est-ce que l'œuvre du poète annonce de notre temps et de sa production culturelle ?
Hölderlin a vraiment cru à la fin des guerres, au moment des paix de Lunéville et d’Amiens (en 1801 et 1802). Mais il a aussi compris, presque au même moment, que la nature allait devenir un tombeau pour la culture. Il est très marqué par le classicisme de Goethe et de Winckelmann. Le grec est sa deuxième langue. Mais il parle aussi français. Tout se joue donc pour lui entre Aristote et Rousseau. La technè (l’art) achève la phusis (la nature) en même temps qu’elle revient vers elle. Elle l’accomplit en même temps qu’elle l’imite. Il faut donc faire retour vers la première quand la seconde commence à ne plus se référer qu’à elle-même. Il faut trouver des noms nouveaux pour retenir les dieux. Seul le poète peut maintenir un lien avec les « Célestes », quand la nature est menacée par la tyrannie de la culture. Mais Hölderlin ne veut pas revenir au Moyen Age, comme ses contemporains. Il cherche à fonder, dit-il, une « Eglise esthétique » bâtie sur le poème. Georges Lukacs avait bien compris, en 1949, que ce poète n’était pas « un bourgeois comme les autres ». Car jamais il ne sacrifia la communauté à l’individu. Il avait même la conviction qu’un sentiment religieux d’un nouveau genre s’imposait à l’heure de la décomposition des vieilles institutions. Mais il n’était ni classique ni romantique. C’est pourquoi, quand Germaine de Staël rencontre Schiller et Goethe pour écrire son De l’Allemagne en 1803, Hölderlin ne fait déjà plus partie du paysage. Sa folie arrange tout le monde. L’heure est au romantisme. Elle sera bientôt à la revanche de la Prusse, c’est-à-dire au ressentiment.
Vous citez la philosophe Simone Weil à diverses reprises, sur la question de la « décréation » et de l'« enracinement ». Quels liens établiriez-vous entre sa pensée, sa vision du politique, et la posture de Hölderlin ?
Je ne suis pas allé jusqu’à établir un lien entre ces deux pensées, même si leur commun amour de la Grèce serait une bonne piste. Il est vrai cependant que pour comprendre ce qu’est un être « décréé », au sens de Simone Weil, un être « qui ne fait plus obstacle entre Dieu et le monde », il faut s’intéresser à ce qu’on appelle, depuis Pierre Jean Jouve, les « poèmes de la folie » de Hölderlin, ceux qui nous restent de ses trente-six dernières années. Toute subjectivité y est détruite. Mais on a là une poésie authentique, célébrant que le retour des saisons ou « la vie des gens simples dans la campagne ». Méfions-nous cependant du terme d’« enracinement ». N’oubliez pas que Simone Weil se disait « enracinée dans une absence de lieu » ! Entre la pesanteur du monde et la grâce des dieux ou « de Dieu » (car Hölderlin n’hésite pas à le nommer ainsi), il y a l’apesanteur du poème, « libre comme l’hirondelle ». Hölderlin était passionné de cartes géographiques. Il offre ainsi de saisissants vols planés au-dessus d’une Grèce imaginaire et presque tangible. Ses seuls vrais amis furent peut-être les oiseaux migrateurs. Paul Celan, qui lui est comparable à maints égards, écrivait que « c’est sur [une] absence de sol qu’est fondé le poème » (Diese Bodenlosigkeit nimmt das Gedicht sich zum Grund). La « patrie » hölderlinienne est cette « absence de sol » ou ce « milieu doré », entre terre et ciel, orient et occident. Mais pas la glèbe épaisse évoquée par Heidegger dans « Les origines de l’œuvre d’art », un texte qui doit pourtant beaucoup à Hölderlin.
Concernant les traductions de Sophocle par Hölderlin, dont l'étrangeté a suscité l'hilarité de ses contemporains, mais qu'un Armel Guerne, plus proche de nous, tiendra pour exemplaires, on a le sentiment que vous en faites la clé de voûte de l'œuvre hölderlinienne…
Je pense en effet que ces deux volumes publiés en 1804 font écho aux deux volumes d’Hypérion, le roman par lequel Hölderlin a inauguré son œuvre sept ans plus tôt. Cette œuvre est absolument centrale. Parce qu’elle se situe au cœur de la vie du poète et parce qu’elle met au jour la structure « calculée » des deux pièces où tout se joue au centre : dans la découverte de la culpabilité d’Œdipe par Jocaste et dans la dénonciation de Créon par Hémon. Pour cela, Hölderlin va devoir montrer que le prophète Tirésias opère une « césure » au début d’Œdipe tyran et une autre « césure » à la fin d’Antigone. Il « appuie » au début de la première pièce et à la fin de la seconde, faisant basculer le temps du destin au pivot du centre de gravité que constituent les paroles de Jocaste, d’un côté, la tirade d’Hémon, de l’autre. Nous avons là, dans ce mécanisme qui rappelle la balance de la justice actionnée par Thémis, l’aboutissement des recherches de Hölderlin : le temps se « retourne » littéralement dans le poème. Les figures tyranniques d’Œdipe et de Créon sont « césurées » ou suspendues par le prophète. Mais leur démesure n’est pas qu’une hubris grecque. Elle symbolise aussi l’ivresse spéculative des ténors de l’idéalisme allemand (Fichte, Schelling, Hegel) que Hölderlin a connus et dont il a partagé la « faute ». Le jugement divin qu’est la parole de Tirésias vient alors « meurtrir » ces esprits orgueilleux, mais non les « foudroyer ». Elle fait d’Œdipe et de Créon - c’est-à-dire aussi de Hölderlin - des suppliants qui survivront au « coup » des dieux.
En vous lisant, on pense aux travaux que vous avez menés avec René Girard. Particulièrement lorsque vous évoquez La Mort d'Empédocle, figure qui renvoie à l'autosacrifice de Hölderlin s'abîmant dans une prétendue folie. Ne pourrait-on pas voir dans le poète le bouc émissaire caché d'une génération égarée dans la poursuite d'idéaux politiques ou philosophiques voués à l'échec ?
Je suis touché que vous évoquiez René Girard. J’ai en effet pensé ce livre comme une suite à celui que nous avions écrit ensemble en 2007, Achever Clausewitz. Hölderlin y tenait déjà une place centrale. Il me fallait mener sur ce dernier une enquête plus approfondie, analogue à celle que nous avions faite sur l’auteur du De la guerre. J’ai donc travaillé sur tous les textes disponibles : lettres, poèmes, roman, tragédie, traités philosophiques ou poétiques. Et j’ai fondé mon interprétation sur le voyage en France, où le poète a dû vivre une expérience décisive. Ses contemporains (Schelling et Hegel en tête) le décriront, à son retour en Allemagne, comme un mendiant méconnaissable. Il y a là une véritable torsion des témoignages, une forme de dénégation ou de construction très romantique de la folie. Je n’ai jamais cru une seconde à ces mirages. Je préfère faire confiance au poète, qui décrivit le Christ comme un mendiant claudicant sous le soleil.
"Le Clocher de Tübingen - Oeuvre-vie de Friedrich Hölderlin" Benoît Chantre - paru aux editions Grasset (2019)