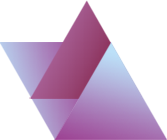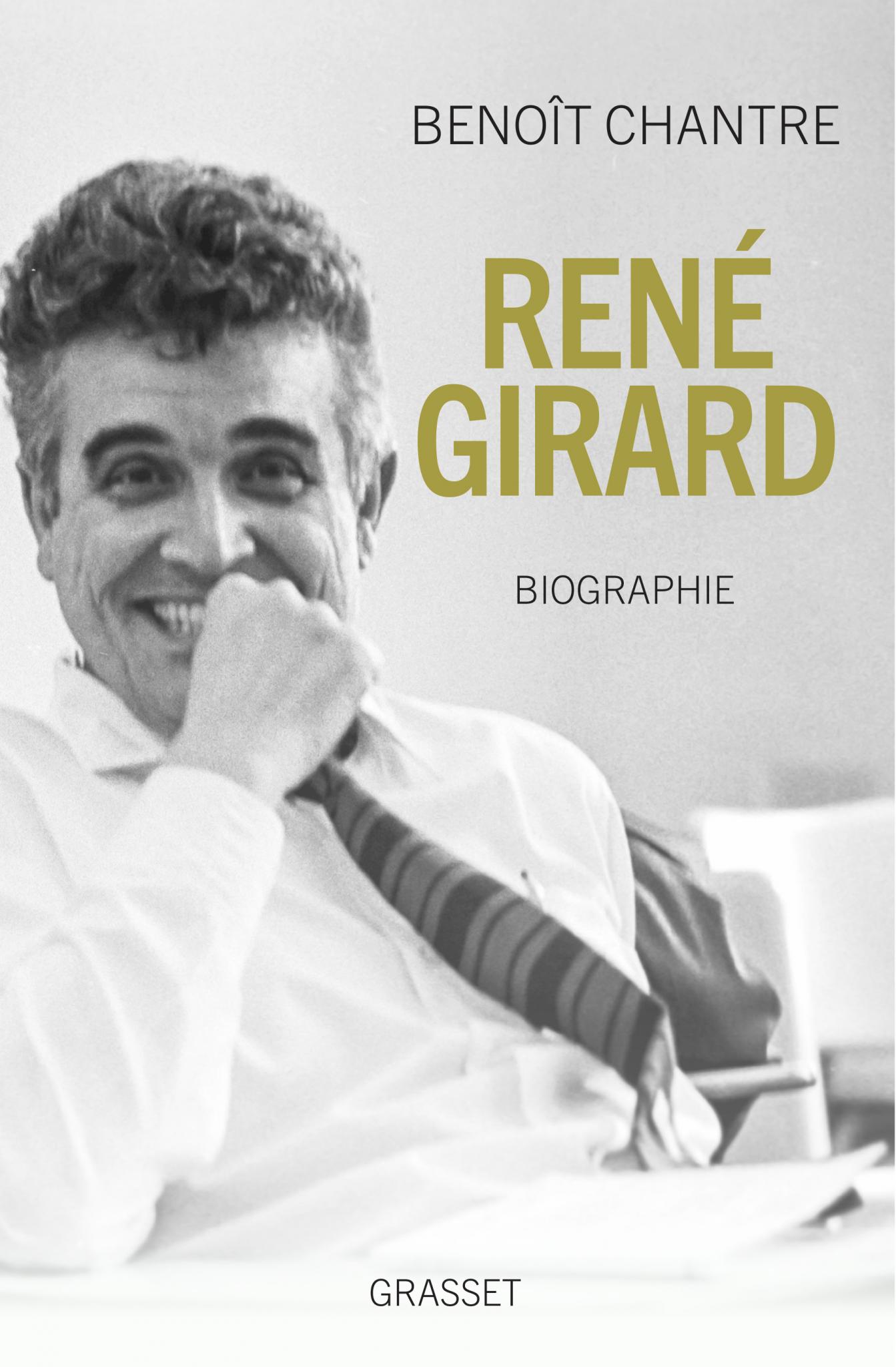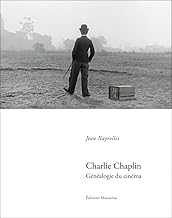Hommage à Roberto Calasso

Hommage à Roberto Calasso
par Benoît Chantre
Roberto Calasso nous a quittés le 28 juillet dernier, des suites d’une longue maladie. Sa disparition nous peine à plus d’un titre. Nous ne perdons pas seulement l’auteur d’une œuvre magnifique et un éditeur de génie, mais aussi l’un des plus brillants interlocuteurs de René Girard, qu’il fit traduire chez Adelphi, la maison qu’il dirigeait depuis 1962. Nous avions eu la joie et l’honneur de pouvoir l’inviter à deux reprises à donner une conférence : le 3 mai 2009, sur « La forêt des Brâhmanas » au Collège des Bernardins, dans le cadre de la Chaire René Girard, et le 4 juin 2014, sur « La superstition de la société », au Centre Pompidou, dans le cadre des Conférences René Girard[1]. Nous avons ensuite continué de dialoguer avec ses livres dans deux séminaires organisés avec notre ami Adrian Navigante, de la Fondation Inde-Europe pour de Nouveaux Dialogues : « Perspectives sur le sacrifice » (à Paris, le 19 octobre 2019, et à Zagarollo les 25 et 26 septembre 2020). Silvia d’Intino nous avait alors éclairés sur la profondeur de la méditation engagée par Calasso sur l’Inde védique, mais aussi sur la façon dont il concevait et construisait son « roman des romans ». Sa disparition est une perte terrible, tant les questions qu’il posait à notre modernité en l’enveloppant dans une mémoire immense, celle du lecteur, de l’écrivain et de l’anthropologue qu’il fut, étaient riches de perspectives. Ses livres continueront de nous aider, même si c’est de façon clandestine, comme il le revendiquait lui-même, à penser une sortie de l’« innommable actuel[2] ».
Plutôt que de lui consacrer une nécrologie, ce que d’autres ont déjà fait, je voudrais risquer en son hommage quelques réflexions qui me sont venues à la lecture du livre de John Freccero sur Dante[3], écrit dans le voisinage de René Girard, et des ouvrages de Roberto Calasso lui-même évoquant ce qu’il appelle la « littérature absolue ». Le hasard veut que nous commémorions aujourd’hui même, mardi 14 septembre 2021, le 700e anniversaire de la mort du poète florentin. Allons donc voir, en ces temps de défiance généralisée, du côté des grands textes et faisons-les dialoguer ensemble. Girard commençait souvent, on le sait, par citer Troïlus et Cressida, où Ulysse raille Agamemnon, dont l’armée s’est défaite en cascade. Le respect s’évanouit de degré en degré, chacun roule pour lui seul. Tels sont les ravages de ce que les modernes appellent l’individualisme, où chacun a toujours raison contre tous. Mais pourquoi est-ce par la voix du marin très rusé que Shakespeare a choisi de révéler cette crise ? Sans doute parce que ce virtuose en mille tours est le plus à même de forcer ses auditeurs à dépasser leurs conflits en l’écoutant. Les Grecs n’en ont pas moins sombré. C’est pourquoi Dante, reprenant une légende médiévale, nous raconte une tout autre histoire que le retour en Ithaque : il affirme qu’Ulysse n’a pas retrouvé son île natale et qu’il a fait naufrage « dans le tourbillon né de la terre nouvelle[4] », alors qu’apparaissait à l’horizon une « montagne brune ». Cette nouvelle terre, c’est le Purgatoire. Ulysse n’aura pu la gravir. À la huitième bolge de l’enfer, Virgile et Dante voient voleter une flamme double. Serait-ce Étéocle et Polynice brûlant sur leur bûcher ? Non, répond Virgile, ce sont Ulysse et Diomède qui « vont ensemble / au châtiment comme ils allaient à la colère[5] ». Certains critiquèrent cet accroc à la légende en prétendant que Dante ignorait tout du poème homérique. C’était faire peu de cas de sa connaissance de Virgile, médiateur entre lui et Ulysse : les paroles de ce dernier ressemblent à s’y méprendre au discours d’Énée dans le premier livre de l’Énéide, à coup sûr modelé sur le texte de L’Odyssée.
Si Virgile relaie Dante pour parler à Ulysse, c’est donc moins parce que le deuxième ignorait le grec, que parce que le premier fait le pont entre un monde disparu, celui des Grecs, et celui qui s’ouvre avec La Divine Comédie - le pont, donc, entre l’héroïsme individuel des Hellènes et la pietas collective des Romains, cette foi civique qui vise à la fondation de Rome, berceau de la catholicité. Entre Orient et Occident, comme entre enfer et paradis, Virgile assure l’équilibre du poème. C’est la raison pour laquelle il ne se retire qu’à la fin du purgatoire. Car le « deuxième Énée » qu’est Dante, s’il est incarné en son temps et pris lui aussi dans les querelles douloureuses du pape et de l’empire, ne se soucie que du salut des âmes au paradis. Virgile est là pour tempérer cette ardeur et retenir un peu le pèlerin du côté des damnés, ne serait-ce que pour mieux entendre leur histoire. Mais pourquoi Ulysse, contrairement à la légende de L’Odyssée aurait-il fait naufrage devant la montagne du Purgatoire ? Le marin le révèle aux deux pèlerins :
Quand je quittai Circé, qui me cacha
plus d’une année là-bas […]
ni la douceur de mon enfant, ni la piété
pour mon vieux père, ni l’amour dû
qui devait faire la joie de Pénélope,
ne purent vaincre en moi l’ardeur
que j’eus à devenir expert du monde
et des vices des hommes, et de leur valeur ;
mais je me mis par la haute mer ouverte,
seul avec un navire et cette compagnie
petite qui jamais ne m’abandonna[6].
Ce que voulait Ulysse, c’était donc devenir un héros de la connaissance, un « expert du monde, des vices des hommes et de leur valeur ». Il lui fallait pour cela briser un tabou : aller au-delà du connu en passant les colonnes d’Hercule. À ses compagnons qui hésitent, il déclare qu’ils ne sont « pas faits pour vivre comme des bêtes / mais pour suivre vertu et connaissance[7] ». Alors les marins enthousiastes « tournent [leur] poupe vers l’orient ». Ils osent prendre à rebours le cours providentiel qui, pour Virgile et Dante, va d’est en ouest[8]. Ils résistent donc au mouvement du poème dantesque, qui vise le salut de tous, au profit de leur seul projet héroïque et théorique (« suivre vertu et connaissance »). Cet orgueil plonge Ulysse en enfer. Dante brise ainsi le temps cyclique de l’épopée homérique, celui du retour en Ithaque, pour ouvrir le temps linéaire d’un tout nouveau récit[9]. Six siècles avant les Romantiques et avec une audace qui, comme l’a remarqué Borges, n’a rien à envier à celle d’Ulysse[10], il formule le projet d’une « littérature absolue », qui serait « expression de la totalité », pour reprendre les termes de René Girard : oracle libéré de toute ambiguïté. Mettant en place la tripartition de l’enfer, du purgatoire et du paradis, il opère une purification progressive de la représentation : réalisme de l’enfer où les individus sont retournés sur eux-mêmes, chacun se méfiant de tous ; onirisme du purgatoire où se libère l’imagination subjective, chacun se rêvant un monde pour lui seul ; analogisme du paradis qui pousse le langage au bout de ce qu’il peut faire, afin d’assurer une communion entre les hommes. Sortir des cadres de la représentation sans tomber dans l’aphasie, fonder une connaissance extatique à la portée de tous : tel est le pari gagné de La Divine Comédie. Et que Dante découvre-t-il au paradis ? Des voix que n’obscurcit plus le corps humain, des esprits « embrasés de charité » apparaissant sur la lune comme « une perle sur un front blanc[11] ». La littérature peut donc dire l’indicible, à condition de ne pas se complaire dans des considérations trop formelles où le poète rivaliserait avec ses pairs. C’est là que nous retrouvons l’œuvre de Roberto Calasso.
Car la cathédrale dantesque, comme le poème homérique, s’est à son tour fissurée avec le temps. Et par une autre brèche vont se glisser ceux qui reliront La Divine Comédie après la Révolution française, en reprenant, dans le sillage de l’Athenaeum, la revue littéraire des frères Schlegel, le projet d’une « nouvelle mythologie ». Car les hommes ne peuvent se passer des mythes. Ainsi le rêve d’une « littérature absolue » reparaît avec les Romantiques qui, de Novalis à Mallarmé (« la destruction fut ma Béatrice »), taquineront le chaos, mais feront parler la langue de façon si absconse qu’ils ne pourront plus prétendre « être la voix de la communauté[12] ». Une telle entreprise a sa grandeur. Mais Roberto Calasso nous a montré que l’apothéose subjective dont elle témoigne annonce aussi les vitupérations nihilistes et anarchisantes d’un Max Stirner dans L’Unique[13], bientôt suivies par les ruminations de l’homme du souterrain dostoïevskien, sur lesquelles Girard a écrit les livres que l’on sait. La « transcendance du Moi » se fige dans le ressentiment, origine des égotismes qui fleuriront en masse au xxe siècle. Voilà l’humanité tout entière entraînée dans « le tourbillon né de la terre nouvelle ». Friedrich Schlegel était pourtant bien parti, lorsqu’il écrivait en 1798 :
Vous sourirez peut-être de cette poésie mystique et du désordre qui pourrait résulter de la foule et de la profusion des poésies. Mais la beauté suprême, bien plus l’ordre suprême, n’est pourtant que celle du chaos, et précisément d’un chaos qui n’attend que le contact de l’amour pour se déployer en un monde harmonique, tel qu’était celui de la mythologie et de la poésie antiques.[14]
La démesure condamnée par Dante au chant xxvi de l’Enfer réapparaissait quand Schlegel poussait l’audace jusqu’à dépasser à son tour l’hémisphère austral, mais en décidant d’aller plus loin encore et de remonter vers l’Inde, nouvel Ulysse haranguant les marins de son Athenaeum :
Si les trésors de l’Orient étaient pour nous aussi accessibles que ceux de l’Antiquité classique ! Quelle nouvelle source de poésie pourrait s’écouler pour nous venant de l’Inde, si quelques artistes allemands avec l’universalité et la profondeur de leur compréhension, avec le génie de la traduction qui est le leur pouvaient vraiment jouir de l’occasion qu’une nation, qui devient de plus en plus obtuse et brutale, sait bien peu saisir. C’est dans l’Orient que nous devons chercher le romantique suprême.[15]
Tout l’argument tient dans la critique de la « nation de plus en plus obtuse et brutale ». L’extrême sophistication de l’idéalisme allemand, qui réinventait alors une Inde imaginaire, se heurte de plein fouet à une mosaïque informe de landgraviats et de duchés seulement unis dans leur humiliation. La « nouvelle mythologie » n’aura pas eu de peuple où s’incarner. Ce choc entre la « suprême » spéculation et la brutalité d’un ressentiment national sera fatale à l’âme allemande[16]. Et les marins romantiques feront naufrage dans la terreur totalitaire, avec son lot de délations et de suspicions en tout genre, chacun se réfugiant à nouveau derrière le Léviathan.
De cet effort prométhéen ne reste, après l’atroce xxe siècle, qu’un individualisme ravageur qui n’a même plus l’idée d’inventer une mythologie. Chacun vit replié sur lui-même, devenu une idole pour lui-même et pour l’autre, n’ayant comme bien commun qu’une idole encore plus grande : celle de la société. Conformément à ce qu’avait entrevu Hölderlin, la nature étouffe aujourd’hui sous la tyrannie de la culture ou la « religion du social », pour reprendre une expression de Roberto Calasso. Elle étouffe dans les rets d’un divin reconduit aux limites de la culture humaine et de sa violence constitutive. Loin de n'avoir qu'une fonction sociale, comme le pensait Émile Durkheim, le sacrifice aura été - avant de revenir de façon sauvage sous le règne de l’« expérimentation[17] » où l’on trafique le vivant - un point d’articulation vital entre la culture et la nature, le visible et l’invisible, les institutions humaines et les puissances surnaturelles. Mais Calasso, contrairement à ce que pensait Girard, n’aura pas fait l’apologie du sacrifice. Tout son souci portait sur les conséquences de son occultation. C’est pourquoi il trouvait de son côté trop radicale l’entreprise de « démystification » qui allait prendre le nom de « théorie mimétique ». Si la littérature est forte d’un savoir formalisable, la science qui en sort ne doit pas oublier d’où elle vient, c’est-à-dire du meilleur de la littérature : de ce que Girard lui-même appelait la « grande poésie ». Les mythes sont choses fragiles, mais ils disposent de ressources insoupçonnées. Il faut toujours se mettre à leur écoute, afin d’écrire les récits que notre temps requiert.
Roberto Calasso vénérait Hölderlin, l’un des rares poètes, me disait-il en 2014, qui ont retrouvé le chemin du divin à l’heure « où le désert croît ». Mais savait-il que l’auteur de Hypérion avait relu Dante en 1796, lors d’un voyage en compagnie de Susette Gontard et de Wilhelm Heinse, traducteur du Tasse et de l’Arioste, lorsqu’il fuyait avec eux l’avancée des troupes françaises ? Savait-il que le même Hölderlin s’opposa à l’Athenaeum des frères Schlegel en tentant de créer sa revue poétique, Iduna ? Ayant échoué à convaincre son éditeur, le poète dut partir en France où il médita sur les destins croisés des Grecs et des « Hespériques », autrement dit des Européens. Si les premiers, pensait-il, avaient sombré en perdant leur nature orientale, les seconds feraient naufrage s’ils se laissaient attirer, comme l’Ulysse de Dante, par cette sauvagerie qui leur était étrangère. Mieux valait donc revenir à la sobriété, car « l’informe, écrivit-il en 1804, s’enflamme au contact de ce qui est trop formel[18] ». Il parlait d’Antigone, qui retrouve la violence originaire des Grecs en s’opposant à la tyrannie de Créon. Mais on ne pouvait mieux dénoncer l’ésotérisme d’un chaos désiré qui se parait alors des couleurs de l’Orient. Au moment même, donc, où Schlegel lançait son entreprise suicidaire, Hölderlin dénonçait l’illusoire divinité d’Empédocle et son « excès d’intériorité[19] ». Il tentait assez désespérément de redresser le gouvernail. Car c’est bien cette « illusion romantique » qui allait structurer l’individualisme moderne.
Mais ne perdons pas espoir pour autant. Le seul fait de pouvoir faire la généalogie de ce mensonge est bien la preuve que Dante nous parle encore, sept-cents ans après sa mort, et que le vieux projet de « littérature absolue » n’est pas éteint. Au moment de lui dire adieu, en ce jour où nous célébrons le poète qu’il gardait vif en sa mémoire, saisissons la perche que nous tend Roberto Calasso. Et si la masse informe que nous voyons apparaître devant nous n’était pas la fin de notre civilisation qu’on nous annonce sur toutes les ondes, mais bien le retour de la « montagne brune » ? Nous retrouverions Virgile et Dante, le temps de rééquilibrer notre barque qui sinon risque de tourner sur elle-même et d’être emportée dans le tourbillon.
>>> Page "Roberto Calasso" sur le site de l'ARM
[1] Ces conférences filmées sont disponibles sur le site de l’Association Recherches Mimétiques : www.rene-girard.fr
[2] Roberto Calasso, L’Innommable actuel, trad. Jean-Paul Manganaro, Gallimard, 2019.
[3] John Freccero, Dante. Une poétique de la conversion, trad. Laurent Cantagrel, Desclée de Brouwer, 2019. Rappelons que John Freccero fut un interlocuteur essentiel de René Girard, dès la fin des années 1950, à l’université Johns-Hopkins de Baltimore.
[4] Dante, La Divine Comédie, Enfer, chant xxxvi, trad. Jacqueline Risset, Flammarion, 1992, v. 137.
[5] Ibid., v. 56-57.
[6] Ibid., v. 91-102.
[7] Ibid., v. 119-120.
[8] « Ils avaient donc navigué vers le couchant puis vers le sud et ils avaient vu toutes les étoiles que comporte l’hémisphère austral. Ils avaient fendu l’océan pendant cinq mois et ils avaient aperçu un beau jour une montagne brune à l’horizon » (Jorge Luis Borges, Neuf Essais sur Dante, Gallimard, coll. « Arcades », 1987, p. 36).
[9] John Freccero, op. cit., p. 249-274.
[10] « Il avait osé devancer les sentences de l’insondable Jugement dernier que même les bienheureux ignorent » (Borges, op. cit., p. 39).
[11] Dante, op. cit., chant iii, v. 14.
[12] Roberto Calasso, La Littérature et les dieux, trad. Jean-Paul Manganaro, Gallimard, coll. « Du monde entier », Gallimard, 2002, p. 24 et p. 126.
[13] Roberto Calasso, « Le barbare artificiel », in La Ruine de Kash, trad. Jean-Paul Manganaro, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1987, p. 325-359.
[14] Cité par Roberto Calasso, La Littérature et les dieux, op. cit., p. 60.
[15] Ibid., p. 61.
[16] Voir sur ce point René Girard, Achever Clausewitz (2007) ; rééd. Flammarion, coll. « Champs ».
[17] Roberto Calasso, La Ruine de Kash, op. cit.
[18] Hölderlin, Remarques sur les traductions de Sophocle, in Œuvres, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », dir. Philippe Jaccottet, 1967, p. 965.
[19] Hölderlin, Fondement d’Empédocle, op. cit., p. 663. Ce texte est écrit en 1798.