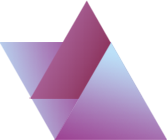Philosophie
INTRODUCTION
La philosophie n’est pas la discipline fondamentale dans laquelle Girard puise ses intuitions puisque : « Seuls les romanciers relèvent la nature imitative du désir. »[1] Elle n’est pas non plus celle dans laquelle il développe les conséquences de ses théories, puisque Girard applique bien plus la théorie mimétique à l’anthropologie[2] qu’à la philosophie. Pourtant, la philosophie hante la théorie mimétique, et ce à plusieurs niveaux.
Tout d’abord en ce que Girard commente de façon explicite certains textes rédigés par des philosophes afin de s’opposer à eux de manière explicite. C’est le cas d’un long article que Girard consacre à la réfutation de la théorie du désir proposée par Deleuze et Guattari dans L’anti-œdipe[3]. Parfois, faute de les réfuter massivement, Girard les dépasse, les complète ou les complexifie, comme il le fait avec le texte de Aron[4] dans sa lecture de Clausewitz[5].
Mais la philosophie est aussi en dialogue avec la théorie mimétique en ce que Girard reconnaît que nombre de philosophes sont passés très prêt du désir mimétique. C’est le cas de Platon qui, s’il a bien perçu le rôle fondamental de la mimesis, s’en est malheureusement tenu au paradigme de la copie, de la re-production ou de l’image. Bien que plaçant l’imitation au cœur même d’une ontologie de la participation, Platon refuse d’étendre la mimesis aux comportements humains et au désir : « C’est Platon qui a déterminé une fois pour toutes la problématique culturelle de l’imitation et c’est une problématique mutilée, amputée d’une dimension essentielle, la dimension acquisitive qui est aussi la dimension conflictuelle. »[6] Mais à l’autre bout de l’Histoire de la philosophie, c’est aussi le cas de Sartre : « Les analyses du rôle de l’autre dans ce que Sartre appelle « le projet » - le garçon de café dans L’être et le néant – les analyses de la mauvaise foi, de la coquetterie, sont merveilleuses à mes yeux. »[7], ou même de Derrida et de ses analyses du pharmakos : « De même que la tragédie, le texte philosophique fonctionne, à un certain niveau, comme une tentative d’expulsion, perpétuellement reprise car elle ne réussit jamais à s’achever. C’est là à mon avis ce que démontre de façon éblouissante l’essai de Jacques Derrida intitulé La Pharmacie de Platon. »[8] Ainsi, à de nombreuses reprises la philosophie a flirté avec le désir mimétique sans ne jamais pouvoir le théoriser complètement ni en percevoir toutes les conséquences.
Enfin, la théorie mimétique est aujourd’hui en dialogue avec la philosophie selon deux modalités distinctes. Tout d’abord, la théorie mimétique sert de méthode herméneutique en histoire de la philosophie en ce qu’elle aide à éclairer les auteurs d’un jour nouveau. Dans un rapport parfois critique à Girard, de nombreux auteurs utilisent la théorie mimétique dans leur propre travail d’histoire de la philosophie. Nous pouvons penser ici à Christian Lazzeri qui applique la théorie mimétique à la logique des conflits chez Hobbes et Spinoza[9], ou encore à Jean-Pierre Dupuy qui propose, avec la théorie mimétique, une solution au problème Adam Smith[10] et toute une lecture de Rawls à partir du concept de sacrifice[11]. C’est aussi le cas de Paul Dumouchel qui offre une lecture girardienne de Marx à partir de la rareté[12], ou de Lucien Scubla qui se demande, dans une lecture de Rousseau, s’il est possible de mettre la loi au-dessus de l’homme ?[13] Stéphane Vinolo a proposé récemment, une lecture de Sartre à l’aune de la théorie mimétique[14]. On notera enfin, qu’Alain Badiou propose de lire la subjectivation du Dieu de Malebranche selon les catégories de la théorie mimétique[15]. Ainsi la théorie du désir mimétique est désormais et pour beaucoup, un véritable outil de la philosophie. Mais au-delà de l’histoire de la philosophie, la théorie mimétique est aussi présente dans la production philosophique contemporaine et pour ce, nous la retrouvons au cœur des textes de Michel Serres et de la logique du parasite[16] ou de la fondation[17], dans le catastrophisme éclairé[18] de Jean-Pierre Dupuy ou encore dans toute la théorie actualiste et formaliste de la justice que propose Charles Ramond[19].
Nous pouvons ainsi déconstruire en partie l’idée du contentieux entre la théorie mimétique et la philosophie, puisque bien que la philosophie ne soit pas au cœur de la théorie mimétique, Girard n’a pas ignoré les philosophes et les philosophes n’ignorent plus la théorie mimétique. Ils vivent en parallèle, dans un dialogue critique fait de rencontres et de prises de distance ; ils travaillent ainsi l’un contre l’autre, tout contre.
> Lire "Girard et la Philosophie" Entretien de Paul Dumouchel (1) avec Andréas Wilmes (2), paru dans The Philosophical Journal of Conflict and Violence (Vol. I, Issue 1/2017)
1 Université de Ritsumeikan, Kyoto
2 Centre de Recherche sur les Liens Sociaux (CERLIS), Université Paris-Descartes
COLLOQUES
BIBLIOGRAPHIE
[1] René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, in De la violence à la divinité, Grasset, Paris, 2007, p. 45.
[2] René Girard, La violence et le sacré, Grasset, Paris, 1972.
[3] René Girard, Système du Délire, in Critique XXVIII, 306, pp. 957-996, 1972.
[4] Raymond Aron, Penser la guerre, Clausewitz, tomes I & II, Gallimard, Paris, 1976.
[5] René Girard, Achever Clausewitz, Carnets Nord, Paris, 2007.
[6] René Girard, Des choses caches depuis la fondation du monde, in De la violence à la divinité, Grasset, Paris, 2007, p. 713.
[7] René Girard, Quand ces choses commenceront, Paris, Arléa, 1994, 1996, p. 162.
[8] René Girard, La violence et le sacré, in De la violence à la divinité, Grasset, Paris, 2007, p. 662.
[9] Christian Lazzeri, Droit, pouvoir et liberté, Spinoza critique de Hobbes, PUF, Paris, 1998.
[10] Jean-Pierre Dupuy, Adam Smith et la sympathie envieuse, in Libéralisme et justice sociale, Paris, Calmann-Lévy, 1992.
[11] Jean-Pierre Dupuy, John Rawls, l’utilitarisme et la question du sacrifice, in Libéralisme et justice sociale, Paris, Calmann-Lévy, 1992
[12] Paul Dumouchel & Jean-Pierre Dupuy, L’enfer des choses, Seuil, Paris, 1979.
[13] Lucien Scubla, « Est-il possible de mettre la loi au-dessus de l’homme ? Sur la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau », in Jean-Pierre Dupuy, Introduction aux sciences sociales : logique des phénomènes collectifs, Paris, Ellipses, 1992, pp.105-143.
[14] Stéphane Vinolo, « Critique de la raison mimétique, Girard lecteur de Sartre », in Charles Ramond, La théorie mimétique, de l’apprentissage à l’apocalypse, PUF, Paris, 2010, pp. 59-104.
[15] Alain Badiou, Le séminaire, Malebranche, L’être 2 – Figure théologique – 1986, Fayard, Paris, 2013.
[16] Michel Serres, Le parasite, Grasset, Paris, 1980.
[17] Michel Serres, Rome, Le livre des fondations, Grasset, Paris, 1983.
[18] Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé. Quand l'impossible est certain, Paris, Seuil, 2004.
[19] Charles Ramond, Sentiment d’injustice et chanson populaire [à paraître].