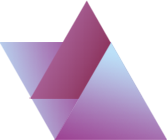Psychologie
Introduction
La psychologie constitue un champ d’application tout indiqué pour la pensée de René Girard et plusieurs psychologues et psychiatres ont développé les intuitions déjà élaborées dans Mensonge romantique et vérité romanesque (où se trouve exposée pour la première fois la théorie du désir « triangulaire ») ou Des choses cachées depuis la fondation du monde (où il s’agit de l’ébauche d’une pensée psychiatrique à proprement parler). Dans ce dernier livre, René Girard, en dialogue avec deux psychiatres, Jean-Michel Oughourlian et Guy Lefort, propose un dépassement de l’optique freudienne et une compréhension renouvelée des maladies mentales.
Pour Girard, ce n’est pas une pulsion spontanée qui nous pousse à désirer telle ou telle chose, mais plutôt l’influence, avouée ou non, d’un modèle adoré et, dans la mesure où celui-ci entre en compétition avec son imitateur, détesté et perçu comme un obstacle. Les symptômes pathologiques surgissent dans le contexte d’une rivalité mimétique aigüe. A mesure que l’objet du différend passe à l’arrière-plan ou même disparaît pour donner lieu au seul face à face entre deux concurrents fascinés, le sujet risque à tout moment de perdre contact avec le réel et de basculer dans la psychose.Cependant les récits de persécution et les hallucinations des patients atteints de troubles psychiques témoignent à rebours d’une réalité que la psychiatrie traditionnelle aussi bien que freudienne ne veut pas voir : le primat de l’autre dans la formation et l’entretien de ce que nous appelons couramment notre « moi », que Jean-Michel Oughourlian va jusqu’à nommer« moi-du-désir ». De récentes découvertes en psychologie génétique et en neurosciences (« neurones miroirs ») viennent conforter les thèses girardiennes.
Interview de Boris Cyrulnik avec Benoit Chantre au siège de l'ARM le 12 mai 2017
Girard et Freud
« L’Œdipe freudien n’est qu’un cas particulier de la rivalité mimétique (…). Le parricide et l’inceste perpétuellement exhibés ne sont qu’un inavouable de pacotille destiné à masquer le véritable inavouable. Invoquer le père et la mère, c’est ne jamais avouer le rôle de l’autre dans le désir, le rôle de l’autre écrivain si c’est un écrivain qui parle (…). Le vrai poisson à noyer n’est presque jamais le père, le rival au passé, l’idole au fond de l’inconscient, mais le rival au présent et au futur, réduit par la psychanalyse au rôle de simple figurant (…). Rien ne fait mieux l’affaire du désir que la minimisation de la seule idole qui l’obsède. » (Critique dans un souterrain, Livre de Poche, biblio essais pp.34-35.)
Ces lignes de Girard sur « l’Œdipe freudien » ne doivent pas occulter l’admiration qu’il a toujours manifestée à l’égard de Freud, « chercheur » d’une scrupuleuse honnêteté, conscient lui-même des difficultés théoriques suscitées par son fameux « complexe ». Peut-on parler d’ambivalence en ce qui concerne la relation Girard-Freud ? Freud a-t-il été le modèle-obstacle de René Girard ? Sont-ils dans une situation de rivalité ?
Laissons au lecteur de Girard le soin d’en décider. Girard a lu Freud (dans la langue de celui-ci) avec l’attention méthodique qu’il a portée à la lecture de Proust et Dostoïevski. Il a comparé les premiers écrits de Freud aux suivants et comparé les œuvres, la psychanalyse d’un côté et la « vérité romanesque » de l’autre. Et il ne fait pas de doute pour lui que ces très grands écrivains sont allés infiniment plus loin dans l’intelligence des rapports de désir que l’inventeur de la psychanalyse. Il en apporte une démonstration essentielle à sa pensée.
Girard montre comment la conception du désir de l’auteur des Frères Karamazov permet d’interpréter Freud mieux que Freud n’est capable de s’interpréter lui-même. Il faut lire à ce sujet : Critique dans un souterrain, pp.26 à 39, où Girard critique la lecture que Freud essaie de faire du roman de Dostoïevski à partir du complexe d’Œdipe. En effet, ça ne fonctionne pas «dans un univers où il n’y a plus que des frères », puisqu’en dépit de son rôle de géniteur, le père Karamazov n’est qu’un « double », le rival de ses enfants.
En ce qui concerne Proust, il faut lire dans Les Choses cachées…, les § F et G du chapitre IV intitulé « Mythologie psychanalytique » dans le livre III consacré à la psychologie. (pp. 480 à 511, Poche, biblio essai). Girard y compare le texte de Freud sur le narcissisme et le démenti apporté à ses analyses par le récit que fait Proust, dans La Recherche… de la rencontre du narrateur avec « la petite bande » sur la digue de Balbec. Proust va plus loin que Freud dans l’analyse du désir parce qu’il ne croit pas à ces entités figées que sont le « désir objectal » et le « désir narcissique» distingués par Freud. Le désir du narrateur n’a pas d’objet, il porte sur le modèle-obstacle incarné par cette bande de filles dont l’autosuffisance (le narcissisme selon Freud) le fascine absolument. Mais cette autosuffisance de l’Autre n’a rien de réel, c’est le fantasme par excellence du désir mimétique, « le dernier miroitement du sacré », nous révèle Girard.
C’est dans La Violence et le Sacré que Girard discute à fond l’œuvre de Freud sous les deux aspects qui intéressent la théorie mimétique : sa conception du désir et son hypothèse du meurtre fondateur. La première, ô combien célèbre, est exposée et discutée au chapitre VII, intitulé « Freud et le complexe d’Œdipe ». La seconde, méconnue et considérée dans les milieux autorisés comme une surprenante énormité, est l’objet du chapitre VIII intitulé : « Totem et Tabou et les interdits de l’inceste ». Elles ont en commun d’être centrées sur le complexe d’Œdipe : la thèse girardienne consiste à faire du fameux complexe l’obstacle majeur, la pierre d’achoppement qui a empêché les « intuitions géniales » de Freud de déboucher sur la théorie mimétique.
Freud aurait reconnu, dans un premier temps, l’existence d’un désir mimétique, sous la forme de l’identification, le désir de l’enfant d’être comme son premier modèle, le père. Mais Freud a toujours soutenu l’idée d’un désir objectal, le désir spontané et indépendant de l’enfant pour sa mère. Et donc, jamais il ne lui est venu à l’esprit de voir dans le triangle familial la (première) figure du désir humain, désir qui se porte spontanément non sur tel ou tel objet mais vers les objets désirés ou possédés par le modèle. Et c’est pourtant parce qu’il est un modèle que le père va devenir un obstacle ; « le petit garçon s’aperçoit que le père lui barre le chemin vers la mère ; son identification avec le père prend de ce fait une teinte hostile etc. » Tout est là : les deux désirs de l’enfant, qui cohabitent un temps, celui d’égaler son modèle et celui de posséder la mère vont entrer en conflit, le désir d’éliminer le père et de le remplacer auprès de la mère va donner naissance au complexe d’Œdipe.
Le complexe d’Œdipe est l’obstacle infranchissable, selon Girard, que Freud a dressé devant des intuitions qui auraient pu le conduire au mécanisme du désir mimétique, c’est-à-dire au « double bind » (l’impératif contradictoire que reçoit l’enfant de son père : sois comme moi, ne sois pas comme moi), au modèle-obstacle, à la rivalité mimétique. Le complexe d’Œdipe exige la conscience, même fugitive, du désir parricide et incestueux, donc la nécessité encombrante du refoulement et de l’inconscient ; il exige aussi d’écarter tout modèle, d’enraciner le désir dans l’objet : ces deux conditions le rendent incompatible avec la rivalité mimétique. Alors que la psychanalyse est contrainte de réorganiser sans cesse les données éparses du désir et pour cela d’inventer de nouveaux concepts, (castration, surmoi, ambivalence, masochisme, homosexualité latente, narcissisme, instinct de mort), la théorie mimétique présente le grand avantage de permettre de déchiffrer le mythe œdipien avec une grande économie de moyens.
Le mythe œdipien a conduit Freud avant Girard sur les traces d’un « meurtre fondateur ». Lisant les mêmes livres (les anthropologues anglais du religieux), Freud et Girard sont frappés par l’ambivalence du rite sacrificiel, considéré comme criminel et comme salutaire. Freud est le premier à faire cette expérience de pensée : imaginer à l’origine des meurtres rituels un événement bien réel, un meurtre collectif, un « modèle » que les rites violents s’efforcent de reproduire. Girard est conduit vers le mécanisme victimaire par Sophocle : Œdipe est « sacrifié » pour débarrasser les Thébains de leur « peste ». Freud, quant à lui, passe tout près de l’hypothèse du bouc émissaire, définissant lui-même le héros tragique comme celui qui est chargé des fautes de la communauté ; mais là encore, il est empêché d’y accéder par son adhésion au mythe œdipien du parricide et de l’inceste. Si Œdipe n’est pas plus coupable qu’un autre, il n’y a plus de « complexe d’Œdipe ».
Selon Girard, Freud a manqué le mécanisme victimaire comme il a manqué la rivalité mimétique et pour les mêmes raisons. L’obstacle majeur rencontré par ses intuitions n’est autre que la figure paternelle. C’est elle qui fait du meurtre fondateur un événement unique, un parricide, de sorte que la genèse de la culture esquissée par Freud n’est qu’un « mythe scientifique » dont on a pu dénoncer les incohérences. La plus remarquée est que Freud engendre la culture à partir de différences qui sont déjà culturelles, les liens de parenté. Pour Girard, si l’on veut remonter à l’origine, il faut faire table rase du sens et oublier toutes ces différences (père-fils, épouse-mère etc.) qui tiennent la violence en respect : le parricide et l’inceste, comme la peste, cela veut dire l’indifférenciation, le règne d’une violence sans raison. Le plus grand tort de Freud, selon Girard, est de n’avoir pas été assez radical ni dans sa critique du sujet (l’hypothèse de l’inconscient est articulée à une philosophie de la conscience) ni dans son anthropologie, hantée par la figure paternelle. Et pour comprendre que le « sans mesure » des emballements mimétiques ne peut être maîtrisé que dans le mécanisme aveugle de la victime émissaire, la « machine à faire des dieux », il faut remplir une condition que Freud ne pouvait remplir : reconnaître la dépendance radicale de l’humanité à l’égard du religieux.
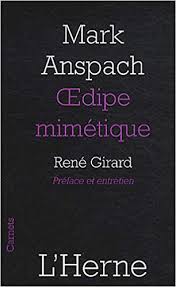
Œdipe mimétique de Mark Anspach, préface de René Girard, Paris, L’Herne, 2010
Tout le monde pense savoir qui est Œdipe : c’est celui qui a tué son père et épousé sa mère. Mais pour René Girard, Œdipe est seulement accusé de ces crimes, il n’est qu’un bouc émissaire. Mark Anspach décèle dans la tragédie de Sophocle des indices qui jettent un doute sur la culpabilité du protagoniste. Sa seule faute serait de se laisser emporter dans les rivalités qui l’opposent aux autres.
Mais n’est-ce pas là une tendance qu’il partage avec le père de la psychanalyse ? L’auteur découvre dans la vie de Freud lui-même des éléments qui confirment les intuitions des romanciers comme George Sand ou Proust. Du petit Marcel au petit Sigmund, en passant par François le champi, il ne s’agit à chaque fois que d’un Œdipe mimétique.
" J’ai tout de suite été séduit par les pénétrantes analyses de Mark Anspach. L’Œdipe qu’il nous livre ici n’est pas celui du fameux complexe mais celui que le complexe dissimule. C’est un OEdipe pour notre temps, un OEdipe pris comme nous dans les symétries aveuglantes du désir mimétique. "
Psychopathologie
Jean-Michel Oughourlian, neuropsychiatre de l ́Hôpital américain de Paris depuis 1974, puis chef du service de psychiatrie à partir de 1981, poste qu ́il occupera jusqu ́en 2007, a été l’un des premiers médecins à percevoir l’importance de cette théorie qui fait inter-agir les désirs humains dans la mise en acte d’une posture de soin.Depuis près de 40 ans, il tente d'appliquer dans le domaine de la psychologie et de la psychopathologie les thèses de René Girard. .
Un mime nommé désir (1982) porte sur les phénomènes de transe, d´hystérie et de possession qu´il décrypte à l´aide de la théorie mimétique. Ce livre s´insurge contre le Freudisme ambiant de l´époque en proposant une phénoménologie de la mimésis, notamment à travers des analyses des pièces de Shakespeare ou d´Edmond Rostand. En 2007, il publie Genèse du désir, où il est question des dernières découvertes en neurosciences (¨neurones miroirs¨) ainsi que d´une approche mimétique à la psychothérapie des couples. Son livre Le Troisième Cerveau (2013) dessine une nouvelle psychologie et une nouvelle psychiatrie, qui imposent notamment une autre gestion de l'altérité, fondée sur la « dialectique des trois cerveaux » : le cerveau cognitif, le cerveau émotionnel et le cerveau mimétique, celui de l'altérité, de l'empathie, de l'amour comme de la haine.
Jean-Michel Oughourlian décrit ici sa rencontre avec René Girard
Son dernier livre Le troisième cerveau, paru aux Editions Albin Michel, 2013, est un apport important à la psychiatrie.
« Ce n’est pas moi qui désire, c’est mon désir qui crée ce que j’appelle “moi”. Et comme ce désir s’avère toujours copié sur celui d’autrui, c’est l’ensemble de la psychologie et de la psychiatrie qu’il faut reconsidérer. L’altérité nous constitue de pied en cap, sur le plan philosophique comme neurologique, et cela change tout, notamment dans nos façons de soigner l’esprit. »
Thèse de médecine (DES de psychiatrie) de Ludovic Macabeao, présentée et soutenue publiquement le 30 octobre 2012, "Apports de la théorie mimétique à la psychopathologie".
Cette thèse offre une synthèse des thèses de René Girard et de Jean-Michel Oughourlian dans le champ de la psychopathologie.
Neurosciences
Dès les années 70 à Seattle les expériences d’Andrew Meltzoff démontrent la primauté de l’imitation chez les nouveau-nés, bouleversant les idées reçues dans ce domaine. Contrairement à ce que pensait Piaget, les enfants n’apprennent pas à imiter à un stade développemental tardif mais au contraire sont des imitateurs dès la naissance.Ou, comme l’a dit Andrew Meltzoff : les enfants sont des « Girardiens naturels».
Les découvertes en neurosciences,et notamment la découverte des « neurones miroirs » par les chercheurs de Parme (Frans de WAAL, Jean DECETY et Vittorio GALLESE) dans les années 90, résonnent de manière suggestive avec les hypothèses girardiennes. Les neurones miroirs sont des cellules cérébrales qui s’activent lorsqu’on fait un geste et lorsqu’on voit quelqu’un faire un geste (surtout si ce geste possède un but défini). Ces cellules ne font aucune différence entre l’exécution et l’observation d’une action. Autrement dit, nous entrons en relation avec les autres, grâce à notre « système miroir » à un niveau profond et de manière inconsciente. Il se peut que ces neurones constituent les bases de nos capacités imitatives en nous permettant de comprendre les intentions de l’autre, au-delà des clivages cartésiens entre l’esprit et le corps.
Ces nouvelles données neurophysiologiques donnaient ainsi une assise scientifique solide à la théorie mimétique développée par René GIRARD à partir des grands textes littéraires qui, depuis Homère, participent à la culture occidentale.
Les neurones miroirs
"La découverte des neurones miroirs est absolument renversante. C'est aussi la découverte la plus importante et elle est pratiquement négligée parce qu'elle est si monumentale que nul ne sait qu'en faire" - Robert Sylvester
La découverte des neurones miroirs en 1990 par l'équipe de Giacomo RIZZOLATTI, directeur du département de neurosciences de la faculté de médecine de Parme a permis à des chercheurs (Frans de WAAL, Jean DECETY et Vittorio GALLESE) de faire un lien entre ces neurones et le mécanisme de l'empathie qui joue un rôle important dans l’action du soin.
Ces nouvelles données neurophysiologiques donnaient ainsi une assise scientifique solide à la théorie mimétique développée par René GIRARD à partir des grands textes littéraires qui, depuis Homère, participent à la culture occidentale.
>
Les neurones miroirs par Jean-Michel Oughourlian
Conférences et colloques
Bibliographie de référence
Mark Rogin Anspach, À charge de revanche. Figures élémentaires de la réciprocité, Paris, Le Seuil, 2002.
Mark Anspach, Œdipe mimétique, préface de René Girard, Paris, L’Herne, 2010.
Jean-Pierre Dupuy, La Panique, Paris, Éditions Delagrange, coll. « Les Empêcheurs de Penser en Rond », 1991 (nouvelle édition : Le Seuil, 2003).
Scott Garrels, ed. Mimesis and Science : Empirical Research on Imitation and the Mimetic Theory of Culture and Religion, Michigan State University Press, 2011.
Henri Grivois et Jean-Pierre Dupuy (sous la direction de), Mécanismes mentaux, mécanismes sociaux. De la psychose à la panique, Paris, La Découverte, 1995.
Daniel Lance, Au-delà du désir, Paris, L’Harmattan, 2000.
Paisley Livingston, Models of Desire. René Girard and the Psychology of Mimesis, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1992.
Marshal l, P. J. & Meltzoff, A. N. (2014): Neural mirroring mechanisms and imitation in human infants. Meltzoff, A. N., & Prinz, W. (2002): Philosophical Transactions of The Royal Society B, 369: 20130620
The imitative mind: Development, evolution, and brain bases. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Jean-Michel Oughourlian, Un mime nommé désir, Paris, Grasset, 1982.
Jean-Michel Oughourlian, Genèse du désir, Paris, Carnets Nord, 2007.
Jean-Michel Oughourlian, Psychopolitique, entretiens avec Trevor Cribben Merrill, préface de René Girard, Paris, Éditions François-Xavier de Guibert, 2010.
Jean-Michel Oughourlian, Le troisième cerveau, Albin Michel, 2013.