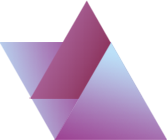Théologie
INTRODUCTION
Dès la parution de La violence et le sacré, Girard a entretenu un dialogue fructueux avec le théologien autrichien Raymund Schwager. Il en est notamment résulté dans les écrits ultérieurs de Girard une reconnaissance de l’ambivalence du mot sacrifice, légitimant la vision positive du
sacrifice comme don gratuit magnifiée par la théologie chrétienne. Cette inflexion a sans doute
facilité une appropriation fructueuse des idées de Girard par un certain nombre de théologiens.
Sous l’éclairage de la théorie mimétique, la passion du Christ reçoit une signification renouvelée, celle d’une révélation anthropologique du rôle des mécanismes sacrificiels dans la vie des communautés humaines. Mis au grand jour par Dieu lui-même occupant la place de la victime innocente, le mécanisme par lequel les sociétés produisent des boucs émissaires est à jamais démystifié, plaçant l’homme face au défi de sa conversion intérieure.
Outil novateur pour l’exégèse, l’approche mimétique met à jour ce fait essentiel que l’ensemble du corpus biblique est structuré par la dénonciation sans cesse plus précise de la violence et de son ancrage dans le désir mimétique et par la révélation progressive de l’absolue non violence de Dieu. Ces thèmes ont été développés par Raymund Schwager lui-même dans un livre traduit en Français (Avons-nous besoin d’un bouc émissaire, Flammarion, 2011), livre qui comporte notamment une analyse sans concession de la violence attribuée à Dieu dans la Bible hébraïque. Parmi les théologiens (protestants aussi bien que catholiques) s’étant inspirés des travaux de Girard, il convient de mentionner Robert Hammerton-Kelly (Sacred Violence: Paul’s Hermeneutic of the Cross, 1992 et The Gospel and the Sacred: Poetics of Violence in Mark, 1994) et James Alison, dont deux ouvrages ont été traduits en français (Le péché originel à la lumière de la résurrection, Cerf 2009 et 12 leçons sur le christianisme, Desclée de Brouwer 2015). En s’appuyant de manière créative sur la théorie mimétique, ce dernier développe une pédagogie très novatrice du christianisme, centrée sur la figure d’un Dieu « source de bonté non-ambivalente », dépourvu de tout esprit de vengeance, qui vient vers l’être humain pour lui offrir la possibilité d’une réconciliation sans réserve et d’une vie entièrement renouvelée.
Ce sont donc les « effets théologiques » de cette anthropologie que des chercheurs ont tenté d'interroger, pour en apprécier la fécondité, dans l’engendrement d’une théologie dont l’expression serait plus abordable par tous les hommes de notre temps.
Dans son livre, Je vois Satan tomber comme l'éclair (Grasset, 1999), René Girard pense, comme Simone Weil, que les Evangiles sont une théorie de l’homme avant d’être une théorie de Dieu. Une carte des violences où son orgueil et son envie enferment l’humanité. Découvrir cette théorie de l’homme et l’accepter, c’est rendre vie aux grands thèmes évangéliques relatifs au mal, oubliés et évacués par les croyants – de Satan à l’apocalypse.
Voici un court interview de James Alison, théologien, qui a travaillé avec René Girard.
James Alison est prêtre catholique anglais, théologien et écrivain. Il est reconnu pour ses travaux sur les applications de la théorie mimétique à la théologie. Il a étudié chez les Dominicains à Oxford. Il est diplômé de la Faculté de Théologie Jésuite (FAJE) de Belo Horizonte. Il est l'auteur de nombreux ouvrages en anglais, dont plusieurs ont déjà été traduits en différentes langues. Il réside à Madrid.
Brève introduction à l'oeuvre de René Girard et ses aspects théologiques :
Emission sur KTO du 24 janvier 2016, avec Benoît Chantre , président de l'ARM, et Jean Duchesne de l'Académie catholique : vidéo (45 mn)
ENTRETIENS AVEC RENE GIRARD
COLLOQUES ET CONFERENCES
ARTICLES
L’anthropologie mimétique de René Girard peut-elle féconder la réflexion théologique ?
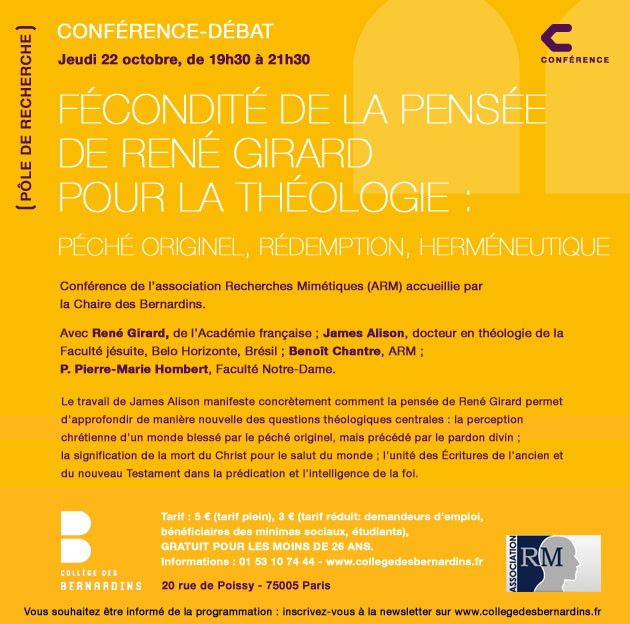
par Père Pierre-Marie HOMBERT,
professeur à la Faculté Notre-Dame de Paris
Allocution fait part lors de la présentation du livre Le péché originel à la lumière de la Résurrection (Préface de René Girard, Paris, éd. du Cerf, 2009), et de la soirée-débat qui eurent lieu, en présence de René GIRARD, le 22 octobre 2009 au Collège des Bernardins de Paris).
Quelques notes pour une lecture girardienne du Livre de l’Apocalypse
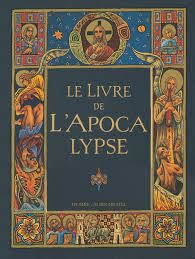
par James Alison
Texte de la conférence de James Alison, donnée au Collège Supérieur de Lyon , à l'occasion des journées «La Philo éclaire la Ville»,
Lyon, France, Jan 23-26 2020
René Girard n’a pas beaucoup écrit sur la Révélation de Jésus-Christ à Jean, également connu sous le nom de Livre de l’Apocalypse[i]. Lorsqu'il fait référence aux textes bibliques dans le registre apocalyptique, il fait un usage préférentiel du texte connu dans les études du Nouveau Testament comme « la petite apocalypse ». La version Marcienne (Marc 13, 1-37) est la plus complète et synthétique, bien que des éléments en apparaissent dans les deux autres évangiles synoptiques ainsi que dans l’Apocalypse.
Certains se sont demandé pourquoi un auteur dont l’écriture, de son premier livre Mensonge romantique et vérité romanesque à son dernier Achever Clauszwitz, est si profondément « apocalyptique », et pour qui l’interaction de la violence et des choses sacrées est si centrale, n’a pas accordé plus d’attention à la mère de tous « les textes sacrés imprégnés de violence apocalyptique ». Et cela semble une question légitime, à laquelle il ne nous donne pas de réponse explicite. Si je devais parier sur la raison de cette absence, je dirais ceci : contrairement aux textes de la « petite apocalypse » des Évangiles[ii], aucun lecteur ne peut aller très loin dans l’Apocalypse sans se retrouver rapidement face à un monde symbolique, historique et exégétique que nous ne connaissons pas et avec lequel les gens ont cessé d'être familiers peu de temps après la rédaction du texte.
.../...
[i] « Apocalypse » est la translitération française (et anglaise) du premier mot du livre, le mot grec signifiant « révélation ».
[ii] J'en parle au paragraphe 8 du présent texte.
Repenser la sacramentalité après René Girard
James Alison COV&R 2022
Comme on le sait, René Girard n'a écrit ni sur les sacrements ni sur l'ecclésiologie. Il s'est plus attaché à retracer les changements produits dans les modèles de désir par les textes juifs et chrétiens - changements ayant conduit au monde moderne. Il a en outre étudiéles façons dont, une fois les désirs humains émancipés et privés de résolution sacrificielle, nous devenons de plus en plus dangereux les uns pour les autres. La question de savoir comment vivre dans ce monde sans être pris dans un maelström de rivalités mimétiques non résolues menant à l'autodestruction était celle qui le préoccupait dans ses dernières années. Comme Benoît Chantre l'a montré, c'est le modèle d'Holderlin plutot que ceux de Clausewitz ou Hegel qu'il cherchait à nous proposer.
Cela dit, rien dans la pensée de René n'empêche de se poser la question de savoir à quoi pourrait ressembler une ecclésiologie fondamentale issue de l'intuition girardienne. Et une bonne partie de cette pensée nous recommande d'adopter une approche sacramentelle de l'ecclésiologie. En fait, René lui-même montrait peu d'intérêt pour la politique ecclésiastique et était enclin à penser que l'Église chrétienne avait échoué, tout au moins que la chrétienté avait échoué. Il participait pourtant régulièrement aux sacrements, ayant été pendant quelque temps ministre eucharistique pour l'aumonerie catholique de Stanford. Par la suite, il assista fidèlement à une messe grégorienne, organisée par un professeur de musique parmi ses collègues de Stanford. Cette messe, avec les prières latines du Missel Paul VI, mais avec les lectures et l'homélie en anglais, était sa discipline hebdomadaire dans une chapelle près de chez lui dans les dernières années de sa vie.
BIBLIOGRAPHE
L’anthropologie de René Girard, fondée sur une description du mécanisme victimaire, a profondément renouvelé notre compréhension du sacrifice. Mais René Girard ne s’est pas contenté de construire une théorie morphogénétique valant pour toutes les sociétés humaines. Il a tenté de montrer comment la révélation chrétienne bouleverse de fond en comble la structure du religieux archaïque : en mourant sur la Croix, le Christ révèle la nature du meurtre fondateur à l’origine de toute institution. Mais René Girard n’est pas théologien.
Ce sont donc les « effets théologiques » de cette anthropologie que des chercheurs ont tenté d'interroger, pour en apprécier la fécondité, dans l’engendrement d’une théologie dont l’expression serait plus abordable par tous les hommes de notre temps.
Alberg, Jeremiah L., Beneath the Veil of the Strange Verses: Reading Scandalous Texts, East Lansing, Michigan State University Press, 2013.
Alison, James :
en français
La Foi au-delà du ressentiment - Fragments catholiques et gays. Cerf, 2021
Le péché originel à la lumière de la Résurrection : Bienheureuse faute d'Adam, Cerf, 2009.
Douze leçons sur le Christianisme, Desclee de Brower, 2015.
en anglais
Knowing Jesus, Templegate, 1994
Raising Abel: The Recovery of the Eschatological Imagination, London, 2010
Bailie, Gil, La Violence révélée. L’humanité à l’heure du choix, ,Castelnau de Lez, Climats, 2004
Marina Copsidas
Les larmes de Pierre
Girard Donadieu
Comprendre René Girard (DVD)
Bouddhisme, Christianisme, Islam, SaintLéger Editions 2015
Gardeil, Pierre :
Quinze regards sur le corps livré, avant-propos de René Girard, éd. Ad Solem, 1997
-"La Cène et la Croix. Après René Girard: Réflexion sur la mort rédemptrice" in Nouvelle Revue Théologique, tome 101, éd. Casterman, septembre-octobre 1979, pp. 676-698
Stéphane Marcireau
Le Christianisme et l’émergence de l’individu chez René Girard
Perret, Bernard :
"Penser la foi chrétienne après René Girard", Ad Solem 2018
"Quand l'avenir nous échappe", Desclée de Brouwer 2020
René Girard, Gianni Vattimo, Christianisme et modernité, éd. Flammarion, coll. Champs Actuel, 2009 (entretiens menés par PierPaolo Antonello)
Schwager, Raymund :
« La mort de Jésus. René Girard et la théologie », Recherches de science religieuse, tome 73, n°4, octobre-décembre 1985;
« Imiter et suivre », Christus, tome 34, n°133, janvier 1987.
Avons-nous besoin d’un bouc émissaire ?, traduit de l’Allemand par Éric Hauessler et Jean-Louis Schlegel, Flammarion, 2011.
Briefwechsel mit René Girard [Correspondance avec René Girard], Nikolaus Wandinger, Karin Peter (éd.), Herder Verlag, 2015.