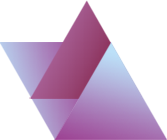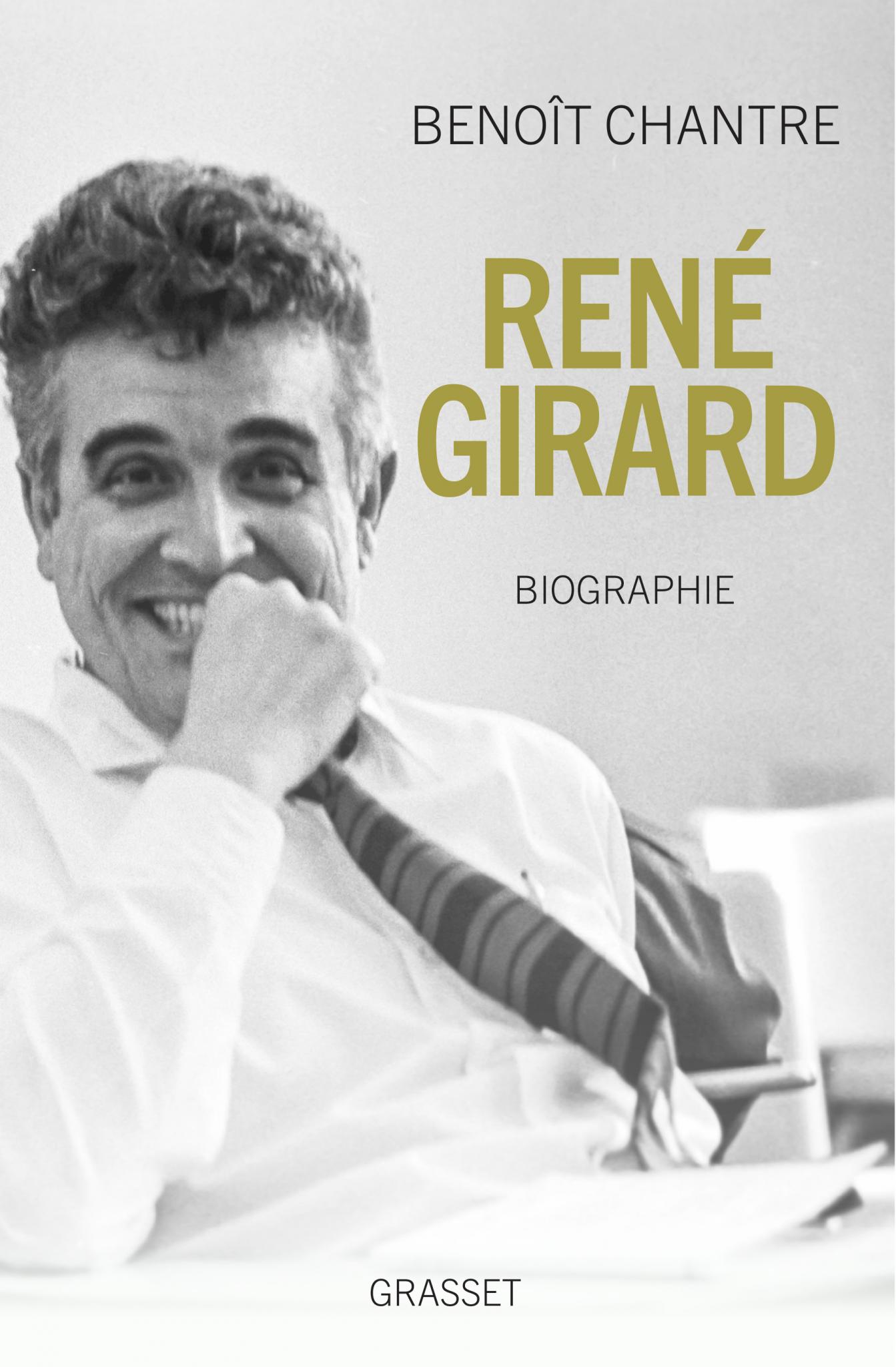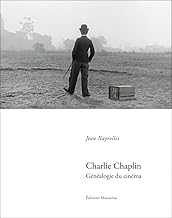Actualités
Actualités 
Edito janvier 2015
Ne parlons plus d’union sacrée
Chers amis,
Nos vœux traditionnels ont été retardés par les événements que nous venons de connaître en France. Certes, ces derniers étaient prévisibles. Mais l’irruption de cette violence visant des humoristes, des policiers et des croyants qui préparaient Shabbat, introduit une dimension irréversible dans notre histoire. Face à ces actes barbares, les rituels républicains ont bien tenu : honneur rendu aux morts par les plus hautes instances de l’Etat, impressionnants défilés pacifiques en province et à Paris, ferme condamnation des meurtres par les instances religieuses s’exprimant ensemble. On peut voir là, entre autres, le fruit de la réflexion critique menée à l’occasion des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Car qui dit « union sacrée » dit reconstitution, sur un territoire donné, d’une paix sociale polarisée par un ennemi commun. Mais nous savons aussi que Daesh n’a d’Etat que le nom et qu’il tire sa force, comme Al-Qaïda, d’être nulle part et partout. Telle est la situation inédite à laquelle nous sommes confrontés. L’unanimisme de ces dernières semaines ne doit donc pas nous détourner de l’effort de compréhension et d’action qui nous incombe. Plus que jamais, une réflexion sur les ressorts de la violence moderne, celle du terrorisme en particulier, s’impose pour que notre réponse à cette violence soit responsable, qu’elle ne relance pas le cycle sans fin de la vengeance.
On nous dit qu’il faut éviter les amalgames. Commençons donc par distinguer la violence politique et la violence religieuse, que le terrorisme confond à dessein. Ou plutôt, ce qui serait plus juste : donnons une interprétation politique d’une violence dont la nature est d’être à la fois politique et religieuse. Les islamistes déclarent la guerre à l’Occident. Leur politique est claire, de ce point de vue : attirer les démocraties européennes dans une nouvelle « croisade contre l’islam ». Leur stratégie aussi : provoquer des guerres civiles au sein de ces démocraties, et ceci de deux manières : en introduisant une division profonde entre les « croyants » et les « non-croyants », et entre les croyants eux-mêmes. D’où leur tactique, enfin, qui vise à frapper en son cœur la liberté d’expression et la liberté religieuse. Du moins est-ce ainsi que nous interprétons les attentats des 7 et 9 janvier. La quasi simultanéité des deux attaques (Charlie Hebdo et Hyper Casher) n’est donc pas aussi fortuite que certains veulent bien le dire : c’est la liberté que nous avons vue attaquée dans les deux cas, parce qu’elle est la pierre d’angle de nos démocraties. La France était touchée en son « centre de gravité », comme dit Clausewitz. D’où l’effet de sidération, dont nous commençons tout juste à sortir. Le moins qu’on puisse dire est que les djihadistes visent juste : puisque les démocraties séparent le spirituel du temporel et que la laïcité est la clé de cette séparation et de cette articulation, ils veulent à nouveau confondre les deux ordres et diviser au nom de Dieu. La dimension mimétique de ce conflit ne doit pas non plus nous échapper : c’est en cherchant à nous entraîner dans une nouvelle croisade que les islamistes entendent mener la leur. Ils voudraient que nous retombions dans l’ornière de l’union sacrée.
Cette violence politique tire des ressources inépuisables de la religion avec laquelle elle se confond. C’est la raison pour laquelle la montée aux extrêmes, après s’être excellemment servie des nationalismes et des totalitarismes, s’accommode aujourd’hui si bien de la théocratie. Les islamistes ont compris que l’Occident vivait de la séparation des deux Cités. Ils voudraient donc le faire revenir sur cette séparation. Ils cherchent alors à l’attirer dans une croisade où chacun fera de l’autre un monstre à éradiquer. Allons plus loin et tirons les conséquences métaphysiques et morales de cette stratégie. Le terroriste ne veut pas voir que l’essence de la violence est de reporter ses torts sur autrui. C’est donc pour pouvoir diaboliser cet Autre que le terroriste se diabolise lui-même. La relance du processus mimétique, et donc du mécanisme victimaire, est à la fois le moteur de la dénégation criminelle et la preuve de son succès. Le terroriste veut la violence en tant que telle, en mettant en scène des actes d’une violence inouïe. Il fait alors apparaître à son insu la vérité mimétique de cette violence. « C’est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaie d’opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité, et ne servent qu’à la relever davantage », écrivait Pascal. Mais l’islamisme n’est qu’un symptôme du nihilisme qui nous ronge. C’est le refus de voir la vérité de notre propre violence qui nous empêche d’avoir une claire intelligence de la situation présente. Raison pour laquelle les djihadistes ont intérêt à brouiller les cartes, à diffuser le religieux comme un poison - ceci pour en faire méconnaître la fonction, qui est aussi d’être un remède.
La solution à cette crise ne doit pas être religieuse, mais politique. Il importe donc de distinguer les deux violences qu’on veut nous voir confondre, de séparer les ordres. Séparer le religieux du politique, c’est épurer le religieux. Péguy dirait : c’est ressaisir la mystique qui pourrait inspirer la politique. Voilà le défi auquel nous sommes exposés, de par la nature politico-religieuse de la violence qui nous frappe. Car la violence religieuse n’est pas en soi une violence politique. Elle est d’abord et par essence une violence rituelle, qui fait une distinction claire entre le meurtre et le sacrifice, la violence illégale et la violence légale. Contrairement au meurtre qui ouvre le cycle de la vengeance, le sacrifice cherche à le refermer. Il prévient les retours d’une violence immaîtrisable, vaccine les hommes contre leur propre violence. Violent, il les préserve de la violence. René Girard a ainsi montré que l’institution du sacrifice cherche à mettre un point final aux représailles. « Catharsis mineure dérivée d’une catharsis majeure », le sacrifice remplace les victimes humaines des lynchages par des victimes de substitution, victimes animales en premier lieu. Cette mort ritualisée, « domestiquée », permet d’éviter les dérapages où le groupe risque de s’autodétruire. Il est très dangereux, en effet, de défouler sa violence de manière aléatoire. La dimension préventive et méticuleuse des sacrifices, soutenue par un ensemble de rites et de prohibitions, a ainsi fondé les institutions qui règlent les relations humaines. Le sacrifice n’est rien d’autre qu’une technique de contrôle de la violence. La répétition rituelle a structuré nos sociétés. C’est donc l’institution sacrificielle qui a permis l’émergence de l’Etat, ce progrès indéniable dans la contention des violences humaines. Mais la réussite de la solution étatique a fini par nous faire oublier que l’Etat s’est émancipé de la violence religieuse pour détenir le « monopole de la violence légitime », comme dit Max Weber. Nous assistons aujourd’hui au retour du refoulé.
Parce qu’il est à la fois poison et remède, le religieux a longtemps été un facteur d’ordre. Mais quand il est entré en rivalité avec le politique auquel il avait donné naissance ; quand il a cherché à reprendre ses droits perdus ; quand il s’est mêlé au politique et du politique, il est devenu un facteur de désordre. Pensons à nos propres guerres de religions. C’est donc à dessein que les islamistes nous empoisonnent avec le religieux en le faisant régresser à un stade archaïque : celui de ces assassinats sauvages, de ces décollations filmées. Mais contrairement à l’idée qu’ils nous inculquent, ce n’est pas la religion qui est cause de la violence - c’est la mimesis. C’est elle qui fait que les djihadistes imitent l’image monstrueuse qu’ils se font de leurs adversaires. En voulant la montée aux extrêmes, ils pensent pouvoir maîtriser la violence, alors que c’est elle qui les maîtrise. Ils refusent de reconnaître qu’on se construit toujours un adversaire à sa ressemblance, ou dont on ne veut pas voir l’altérité. Nos ennemis veulent en ce sens que nous les imitions, que nous redevenions théocratiques en défendant notre croyance (qu’elle soit religieuse ou athée) contre la leur. Il faut croire que cette stratégie réussit bien, car nous avons tendance à jeter le bébé avec l’eau du bain, à condamner unanimement le religieux, même à prétendre parfois vouloir « l’éradiquer ». Ce zèle dangereux nous fait perdre de vue sa fonction régulatrice. Et nous finissons par partager à notre insu l’idée que nos adversaires se font de Dieu. Le Dieu qui les fascine, nous le rejetons avec horreur. C’est donc que nous avons le même, puisqu’il est le Dieu de la violence. Nous sommes en pleine méconnaissance. Voilà le piège qu’on nous tend. Tant que Dieu sera un « modèle-obstacle », pour reprendre les termes de René Girard, c’est à dire un Dieu fait de main d’homme ; tant que la Loi sera une « occasion de péché », comme l’affirme saint Paul dans son Epître aux Romains, nous resterons au cœur de ce cycle indéfini de transgression et de vénération, au cœur de la violence et du sacré.
Si nous concevons, en revanche (et cette expérience de pensée est en même temps une expérience morale), un Dieu vraiment transcendant, alors une alternative non-violente à la violence devient possible. Le pécheur fétichise la loi en entrant en rivalité avec elle ; le fidèle écoute Celui qui parle dans la loi. Dieu cesse alors d’être un « médiateur externe », pour reprendre les termes de René Girard. Il est encore moins un « médiateur interne » ou un rival. Il devient un « médiateur intime » (un « Dieu lointain qui vient du dedans », dit Levinas). L’injonction éthique s’adresse au cœur de la personne morale en la rendant « responsable pour autrui ». Cette assignation est le centre des révélations biblique et chrétienne. Le Dieu qui prend le parti des victimes est un Dieu qui m’intime à me tourner personnellement vers l’autre. Cette pensée et tous les actes qu’elle détermine correspondent à ce que Bergson appelait une morale et une religion « ouvertes ». Cette pensée et ces actes invitent à ne pas ressasser la lettre, mais à réveiller l’esprit qui dort en elle. Toute religion est ainsi prise dans la polarité fondamentale de l’Ouvert et du Clos, du sacrifice et de la fraternité. C’est dans ce sens que le pape François vient de déclarer qu’il ne faut pas se moquer de la foi. La foi est d’abord confiance en l’autre. Si toute religion se doit d’être fidèle à ses rites, c’est pour en maintenir l’esprit, pas pour en imposer la lettre. L’esprit vivifie, la lettre tue. Le mimétisme peut alors jouer dans le bon sens : la foi d’autrui peut réveiller la mienne. Mais il faudra toujours un tiers pour être garant de cette ouverture et pour permettre la justice. Raison pour laquelle les terroristes cherchent à défaire l’articulation, par le droit, du spirituel au temporel. Ils veulent que chacun combatte au nom de son propre Dieu, ou au nom de son refus de Dieu. Ce qui revient au même.
L’Occident a des armes pour contrer cette stratégie perverse : elles sont spirituelles, plus que strictement religieuses, et font la force de la culture européenne. Car la transcendance verticale qui nous libère du sacré, a aussi sa dimension horizontale et historique. Il nous faut ici rappeler que l’idée européenne, celle d’une ouverture essentielle et d’un nouveau départ, est née de la conscience de l’effondrement imminent de ce que saint Paul appelait « les Puissances et les Principautés ». L’aventure chrétienne a lancé l’Europe, en lui donnant sa dimension proprement transcendante, « trans-religieuse » : « Il n’y a ni Juif, ni Grec, il n’y a ni esclave, ni homme libre », écrivait l’apôtre dans l’Epître aux Galates. Cet élan toujours en quête de sa forme politique, fut souvent contredit par de cruelles retombées, de cruelles trahisons, mais il n’a pas cessé de travailler l’histoire occidentale, de lui donner son sens. Autant qu’avec les restes du paganisme, les religions juive et chrétienne ont dû ensuite coexister avec une troisième religion se réclamant d’un Dieu unique, et entrer en dialogue avec elle, comme le suggère la Cinquième Sourate du Coran. Saint Paul avait compris par avance les difficultés de ce type de coexistence, lorsqu’il invitait ceux qu’on n’appelait pas encore chrétiens à vivre dans un rapport dialectique avec leur religion-souche. L’histoire du christianisme a montré combien cette relation était douloureuse et complexe. Il aura fallu les horreurs de la Shoah pour qu’elle devienne vraiment possible. C’est pourquoi le dialogue entre les religions doit devenir une arme contre la montée aux extrêmes, quand de nombreux conflits reprennent les oripeaux des vieilles haines, la grammaire et la syntaxe des religions closes. A l’heure où l’Etat est en train de perdre son autorité et où les trois religions monothéistes se crispent de manière identitaire, c’est ce ressaisissement spirituel que devrait permettre une laïcité ferme, c'est-à-dire capable de comprendre le religieux pour inspirer une politique. Nous en sommes encore loin.
Car le débat a été clos à peine entamé. Comme il ne fallait pas évoquer les « valeurs chrétiennes » de l’Europe, on préféra gommer, il y a quelques années, toute référence au religieux, de peur qu’il ne revienne. La Constitution européenne partait d’un mauvais pas. Ce déni de la pensée religieuse (beaucoup plus que du « fait religieux », qu’on est bien forcé de reconnaître), n’était-il pas un déni de l’Europe elle-même ? On ne voulait pas voir, entre autres, la force de la diagonale paulinienne, le rapport dialectique qu’elle instaure entre toutes les identités. Or c’est ce dialogue qui a donné son élan à la civilisation européenne : le mouvement paulinien vers « tous » les peuples, n’avait de sens que s’il ramenait tous les peuples vers Israël et Israël vers tous les peuples. Les termes de cette dialectique ont bougé avec l’irruption d’autres partenaires, mais la défense de la civilisation européenne en devient plus cruciale, à l’heure où l’Europe politique est en panne. A chaque tradition de défendre ses positions, à condition qu’elles soient risquées sur la « table servie du dialogue ». Je voudrais saluer ici la mémoire d’Abdelwahab Meddeb, poète et penseur de la rupture abrahamique, avec qui j’eus cette longue, passionnante et difficile discussion, au soir d’une rencontre dans la ville de Fès, en 2009. Nous convenions tous deux que les trois monothéismes devaient dialoguer. Je lui rappelai aussi, puisque c’était le sens de mon intervention, que les premières pages de La Violence et le sacré affirment que la tradition musulmane témoigne d’une vraie intelligence du sacrifice, puisque, comme l’écrit René Girard, « c’est le bélier déjà sacrifié par Abel que Dieu envoie à Abraham pour qu’il le sacrifie à la place de son fils Isaac ». Le Coran rompt donc lui aussi sur ce point avec le religieux archaïque. On pourrait même dire qu’il pousse plus loin l’interprétation biblique, lorsqu’il ne mentionne pas un ordre de Dieu donné à Abraham, mais un rêve d’Abraham où ce dernier se voit lui-même tuer son fils (Sourate 37, 102). Il en va également ainsi pour l’histoire de Joseph, où le Coran prend à nouveau le parti des victimes. Le djihadisme trahit donc, en abusant de la rhétorique victimaire, ce qui constitue l’un des points fondamentaux de sa propre tradition.
Comment passer de la violence du religieux au partage des traditions, du sacré au saint ? Comment inspirer une politique juste ? L’anthropologie girardienne peut aider à résoudre ces questions qui sont liées. Car la sortie du religieux sacrificiel ne pourra pas se contenter d’être une condamnation vertueuse de la violence qui le constitue. Il faudrait pour cela comprendre qu’il y a beaucoup de lucidité dans la méconnaissance rituelle, et beaucoup de méconnaissance encore dans la lucidité juridique et politique. Nous allons devoir réinventer nos rituels, c'est-à-dire nos relations, totalement repenser le bien commun. La vraie laïcité est à ce prix. Et elle aura besoin d’interroger les religions. Les démocraties européennes retrouveront-elles alors assez de ressources spirituelles pour échapper au piège que leur tend le djihadisme ? Deux conditions semblent s’imposer : avoir une claire conscience de ses racines ; chercher une réponse politique, et non religieuse, à cette situation de crise. Mais l’intelligence du religieux, au sens objectif et subjectif de l’expression, c'est-à-dire sa sagesse propre et la connaissance dont il doit devenir l’objet, inspirerait cette politique. Les religions seraient remises à leur place ; leur dignité leur serait aussi rendue. La mystique doit dynamiquement finir en politique, le spirituel s’articuler sur le temporel, mais sans jamais se confondre avec lui. En cela, il y a bien en France une mystique républicaine, comme Péguy affirmait qu’il y avait une « mystique dreyfusiste » (« recoupement en culmination de trois mysticismes au moins : juif, chrétien, français »). Cette mystique républicaine est la « table servie du dialogue ». Mais ce dialogue a trop souvent souffert de la domination d’une religion. Ne faisons donc pas du laïcisme à son tour un dogme qui dominerait les autres. Il y aurait à nouveau confusion des ordres, républicanisme et non pas République, c'est-à-dire « chose commune ». La laïcité devrait permettre aux religions de mieux dialoguer, leur assurer et leur reconnaître une égale dignité. En cela elle servirait la politique.
Les événements nous ont donné quelques raisons d’espérer. Ils intervenaient au moment même où le dernier roman de Michel Houellebecq, Soumission, laissait à grand bruit entendre que seul l’islam pouvait apporter du souffle à une République efflanquée et à un christianisme moribond, mais à condition de supprimer la liberté et l’égalité, et de ne garder que la fraternité de l’Oumma, celle des individus soumis mais solidaires. Or les réactions spontanées aux attentats ont tout de suite fait mentir cette fiction et pour un temps conforté l’idéal républicain. L’espoir soulevé par les manifestations des 10 et 11 janvier ne doit donc pas être caricaturé par un retour aux positions d’antan. Il nous faut rester fidèles à cet événement, si nous voulons qu’il ait été un événement. Alors la réponse politique aux attentats perpétrés sur notre sol ne fera pas balbutier l’histoire. J’ai vu, suspendus aux balcons du boulevard Voltaire, une croix, un croissant et une étoile se détacher sur les couleurs du drapeau français. Et tous semblaient d’accord : on ne négocie pas sur la liberté, liberté religieuse et liberté d’expression. Mais cet accord ne tiendra que si chacun respecte, et écoute, la foi de l’autre : égalité et fraternité. Telles sont nos trois vertus républicaines. Il faut espérer que les nombreux chefs d’Etat présents à Paris, le 11 janvier, ont entendu ce message. A ceux qui veulent détruire ces trois valeurs, il faudra répondre non pas en « justifiant la force » mais en « fortifiant la justice », comme dit encore Pascal. Car la guerre qui s’annonce est inédite, à la fois intérieure et extérieure : guerre contre des préjugés tenaces et contre des adversaires invisibles mais déterminés. Ne parlons donc plus d’ « union sacrée », mais d’unité responsable. Penser la violence à travers le religieux, en comprenant qu’il fut longtemps la seule réponse possible à la violence, c’est découvrir aussi que la violence n’est pas originaire, qu’elle est une trahison de la relation morale. Il nous faut ressaisir cette relation que la violence a profanée ; il nous faut la réinventer.
Je vous souhaite à tous une bonne année.
Benoît Chantre
Président de l’Association Recherches Mimétiques